
|
Chroniques de la Conquête du Pérou
"Cruautés des Espagnols" |
|
1) Chroniques rédigées par les conquistadors ou les témoins oculaires de la conquête du Pérou :
Chroniques
de la Conquête du Pérou "Cruautés des Espagnols"
(gravure de De Bry, 17e s.)

1)
Chroniques rédigées par les conquistadors ou les
témoins oculaires de la conquête du Pérou
:
Francisco
de JEREZ : La Conquête du Pérou (1534) . Ed. A.M.
Métailié, Paris 1982.
Né vers 1497 à Séville, ce lettré partit
à quinze ans pour Panama pour y faire l'écrivain
public. Pizarro l'engagea comme secrétaire en 1524 et l'emmena
dans sa première expédition. Xerez fut un de ceux qui
renoncèrent en août 1527, lors du fameux épisode
des "Treize de
l'île du Gallo". Lors de la
conquête, il rejoignit le gouverneur à Coaque en
août 1531, en tant que rapporteur officiel. A Cajamarca, dans
le bref combat qui aboutit à la capture de l'Inca Atahualpa,
il eut une jambe cassée et en resta handicapé.
En juin 1534, il était de retour à Séville et
fit publier sa Verdadera Relacion de la Conquista del
Perú, qu'il qualifie de "vraie" pour contrer celle de
Cristobal de Mena, déjà parue. On lui a attribué
en outre la Relacion Samano-Xerez qui est
antérieure (1528), et relate brièvement les deux
premiers voyages de Pizarro au Pérou.
Cristobal de MENA : Conquista del Peru
llamada la Nueva Castilla (1534) . Extraits publiés par
Francisco Carrillo dans "Cartas y cronistas del descubrimiento y la
conquista", Ed Horizonte, Lima 1987.
Venu au Pérou avec Pizarro en 1531, ce capitaine cavalier fut
d'abord un de ses favoris, puis tomba en disgrâce,
peut-être à cause de ses bonnes relations avec Almagro.
Il en résulta qu'il fut l'un des moins bien servis lors du
partage du butin réuni à Cajamarca. Il le prit assez
mal et rentra en Espagne en décembre 1533. Dès avril
1534, il fit publier sous l'anonymat sa chronique, où il
exhale toute sa rancoeur à l'encontre du clan des Pizarro.
L'auteur de ce que l'on appella longtemps "l'Anonyme Sévillan
de 1534" ne fut identifié qu'en 1935 par Raul Porras
Barrenechea.
Pedro Sancho de LA HOZ (1534) .
Extraits publiés par Francisco Carrillo dans "Cartas y
cronistas del descubrimiento y la conquista", Ed Horizonte, Lima
1987.
D'abord simple fantassin, il devint secrétaire de Pizarro et
chroniqueur officiel après le départ de Francisco de
Jerez. Il le resta jusqu' au 15 juillet 1534 où il mit
à Jauja le point final de la "Relation pour S.M. de ce qui
arriva pendant la conquête et la pacification de ces provinces
de la Nouvelle-Castille et de la qualité de la terre,
après que le capitaine Hernando Pizarro s'en alla porter
à S.M. la relation de la victoire de Caxamalca et de la
capture du cacique Atabalipa".
Le manuscrit original de sa chronique est perdu; les versions
modernes en espagnol, la première datant de 1849, sont des
traductions de l'édition italienne de Ramusio, publiée
à Venise en 1550.
"Nouvelles certaines des Isles du
Pérou" (1534)
Ce petit opuscule, publié à Lyon en 1534 et dont
l'unique exemplaire est conservé à la North Library du
British Museum, est aussi appelé par les historiens "La
Relation française de la conquête du Pérou". Un
long sous-titre précise :
"S'ensuyvent les lettres de Francoys Pizarro gouverneur du riche pays
et province nommee le Pérou faisant mention des merveilleuses
choses tant veuez par ses propres yeux que par lettres à lui
envoyees par ceulx qu'au mesme pays habitent aux quelles sont
contenues plusieurs choses nouvelles tant des richesses inextimables
d'or et d'argent et pierres précieuses en cette province
trouvees et d'iceluy pays emenées que de plusieurs aultres
marchandises et richesses, et ce depuis le temps qu'il monta sur mer
jusques à présent."
L'ouvrage semble en fait une compilation de diverses lettres et de
courtes relations manuscrites, sans doute originaires de Panama, qui
collent d'assez près aux relations de Francisco de Xerez,
Miguel de Estete, Pedro Pizarro, Cristobal de Mena et Diego de
Trujillo. L'éditeur, en bon sujet de François Ier,
égratigne au passage la conduite des Espagnols et explique la
révolte des indiens de l'île de Puna contre les hommes
de Pizarro par les mauvais traitements que ces derniers avaient fait
subir aux femmes indigènes. Un point très
intéressant pour les historiens concerne les
évènements de Cajamarca : d'après cette
relation, Atahualpa et son cortège seraient entrés
armés sur la place de la ville et une division de 4000 soldats
incas se tenait prête à couper la retraite de
Pizarro.
Miguel de
ESTETE : Noticia del Peru (1535) . Extraits publiés par
Francisco Carrillo dans "Cartas y cronistas del descubrimiento y la
conquista". Ed Horizonte, Lima 1987.
Capitaine issu d'une noble famille, il rejoignit Francisco Pizarro en
1531, participa à la capture de l'Inca Atahualpa à
Cajamarca et, pendant que celui-ci était gardé
prisonnier, accompagna Hernando Pizarro dans sa fameuse
expédition à Pachacamac, dont il tint le journal en sa
qualité d'inspecteur de la Real Audiencia.
Sa relation, écrite en 1535 est d'un grand
intérêt et d'une impartialité convenable. Elle ne
fut publiée pour la première fois qu' en 1918.
Diego de TRUJILLO : Relacion del
descubrimiento del Reyno del Perú (1571).
Pizarro ramena en 1530 de Trujillo ce fantassin sans patronyme. Il
participa aux évènements de Cajamarca, de Jauja et de
Cuzco. En 1534, il partit avec Alvarado pour le Guatemala, puis
rentra en Espagne deux ans plus tard. Sa fortune rapidement
épuisée, il dut retourner au Pérou en 1547,
après avoir été témoin à
décharge au procès d'Hernando Pizarro. Il se fixa
à Cuzco et recueillit chez lui les petits enfants d'Atahualpa
dont il assura la tutelle.
C'est à la demande du vice-roi Toledo qu'il
écrivit sa chronique qui couvre la période 1530-1571.
Quoique brève, elle donne des informations originales. Le
manuscrit en est perdu, mais Raul Porras Barrenechea l'édita
en 1948, d'après une copie trouvée dans la
bibliothèque du Palais Royal de Madrid.
Pedro PIZARRO
: Récit de la découverte et de la conquête des
royaumes du Pérou (1571). Ed. du Félin, Paris 1992.
La première traduction en anglais est due à Philip
Ainsworth Means, 2 vol., New York 1921.
Cousin germain de Francisco par leurs pères, il entra comme
page à son service à quinze ans, et partit avec lui
pour le Pérou en 1530. Il participa donc à
l'expédition de Cajamarca, où l'Inca Atahualpa fut
capturé, puis fit partit de la troupe commandée par
Hernando Pizarro qui marcha sur Cuzco et dut défendre la ville
contre les assauts de Manco Capac (1536), épisode où
Juan Pizarro perdit la vie.
Son ouvrage, qui couvre les évènements survenus entre
1529 et 1554, est très influencé par les consignes
passées aux écrivains par le vice-roi Toledo,
tendant à propager la vision selon laquelle les Incas
étaient des usurpateurs et des tyrans qui faisaient plier les
populations indigènes sous un joug dont les conquistadors les
avaient libérés. Il en profite au passage pour
magnifier la figure de son cousin Francisco Pizarro (assassiné
en 1541) dont la mémoire ne semblait déjà plus
en grâce après la période tourmentée des
guerres civiles qui opposèrent les différents partis de
conquistadors juste après la conquête.
Fray MARCOS de NIZA (1495-1558)
Ce franciscain originaire de Nice partit rejoindre Pizarro lors de la
conquête du Pérou. Mais il s'opposa très vite au
clan des Pizarro, dénonçant les cruautés
espagnoles envers les Indiens. En 1534, il fit partie d'une
expédition conduite en Equateur par Pedro de Alvarado avant de
partir pour le Guatemala en 1536 et le Mexique en 1537.
Il est l'auteur de plusieurs chroniques qui ont été
perdues, parmi lesquelles une Historia de la conquista de la
provincia del Perú et une Historia de la conquista de
la provincia de Quito où il stigmatise, entre autres
choses, les atrocités commises par Sebastian de
Benalcazar.
Fray Marcos de Niza fit partie de ce groupe de Franciscains
millénaristes et utopistes, qui essayèrent
d'établir des sociétés idéales indiennes
en Amérique. Ami de Bartolomé de Las Casas, il lui a
fourni l'essentiel des informations dont ce dernier a disposé
sur le Pérou.
Sur cet auteur, il existe une page web (en français)
complète et riche d'indications bibliographiques :
http://perso.club-internet.fr/mnallino/marc.html
Pedro CIEZA
DE LEON : El Señorio de los Incas (1550).
Né en Estrémadure en 1522, il était de bonne
famille et reçut une certaine éducation qu'il abandonna
pour courir l'aventure à treize ans. D'abord, il servit en
Nouvelle-Grenade (Colombie) sous divers capitaines. Dès 1541,
il avait entrepris de noter avec précision tout ce qu'il
observait. En 1547, il passa au Pérou avec Sebastian de
Benalcazar afin de soutenir le président La Gasca
aux prises avec la rébellion de Gonzalo
Pizarro.
De Popayan au lac Titicaca, il continua de décrire, à
la façon d'un guide, les régions traversées. Ces
relations de voyages constituent la première partie de sa
Chronique du Pérou. Ayant appris quel était son
passe-temps, La Gasca le chargea de relater l'histoire et les
institution des Incas, en le dirigeant vers les notables susceptibles
de l'informer. Ce sera la deuxième partie de son oeuvre, El
Senorio de los Incas (1548-1550), qui fut soumise à des
membres de la Real Audiencia de Lima, versés dans les affaires
indigènes. Les dons d'observation de l'auteur sont aussi
indicutables que son honnêteté intellectuelle, et sa
sympathie envers les vaincus ne manque pas de bon sens.
La paix rétablie, Cieza rentra en Espagne et, installé
à Séville, se maria. Il eut le temps de terminer son
oeuvre, la troisième partie de la Chronique du Pérou
qui relate la conquête, et la quatrième qui traite des
guerres civiles entre conquistadores, avant de mourir subitement, le
2 Juillet 1554. Une copie partielle permit des éditions
défectueuses et limitées, du milieu du 19e
siècle à 1979, date où le manuscrit autographe
fut retrouvé à la Bibliothèque Vaticane.
Juan de BETANZOS : Suma y Narracion de
los Incas (1551). Ed. Atlas, Madrid 1987.
Né en Galice, il vécut à Valladolid d'où
il partit en 1523 pour Saint-Domingue. En 1539, il y était
secrétaire de la Real Audiencia et d'un serviteur ou esclave
péruvien qu'il avait acheté, apprit un peu de
quechua.
En 1542, on le retrouve à Cuzco, interprète officiel de
la couronne. Comme tel, il participa en 1544 aux enquêtes du
gouverneur Vaca de Castro, puis sur l'ordre du vice-roi
Mendoza, il interrogea les Incas les plus âgés sur
l'histoire de la dynastie.
Son oeuvre est la compilation-traduction, à peine
arrangée, de ces "interviews" rendus sans doute plus faciles
de par son mariage avec doña Angelina Yupanqui, veuve de
l'Inca Atahualpa et ex-concubine de Francisco Pizarro.
La supériorité de cette chronique sur beaucoup d'autres
réside, malgré un style assez éprouvant, dans
ses sources d'information elles-mêmes, c'est-à-dire des
Incas contemporains des règnes de Huayna Capac et de la guerre
civile entre Huascar et Atahualpa.
Cristobal de MOLINA, dit "El Chileno" :
Relacion de muchas cosas acaescidas en el Perú (1552).
Jeune prêtre séculier, imprégné des
idées généreuses de Bartolomé de Las
Casas, il débarqua au Pérou en 1535, peu
après après la fondation de Lima (6 janvier), et gagna
Cuzco avec Almagro, qu'il accompagna comme aumônier de son
armée dans la conquête ratée du Chili.
Le comportement de ses compatriotes l'horrifia et il
dénonça leurs excès dans sa relation. Bien que
non datée et non signée, cette chronique lui est
attri-buée par Jimenez de la Espada. Porras, quant à
lui, pense qu'elle pourrait être l'oeuvre de frère
Bartolomé de Segovia, religieux qui participa également
à la conquête du Chili.
S'il est bien l'auteur de la chronique, Cristobal de Molina y survole
les évènements de la conquête du Pérou,
qu'il n'a pas vécu, mais donne des informations
intéressantes sur les Incas et leurs fêtes religieuses.
Il est l'un des premiers à s'étendre sur les
cruautés commises par les Espagnols à l'égard
des Indiens. A tel point que Las Casas le copia abondament dans sa
propre Historia Apologetica . Sa chronique fut d'abord
publiée en français en 1842, puis en espagnol en 1870
à Santiago du Chili.
Agustin DE ZARATE : Historia del
descubrimiento y conquista de la provincia del Perú
(1555). Secrétaire du Conseil Royal, trésorier, il
fut envoyé au Pérou en 1544 pour en vérifier les
comptes et rétablir les rentrées d'impôts mises
à mal par les guerres civiles. Son neveu Polo
de Ondegardo l'accompagnait.
Attaché à l'infortuné Blasco Nuñez de
Vela, il n'aboutit à rien et fut relevé. Rentré
en Espagne avant 1549, il fut envoyé dans les Flandres comme
superintendant des finances. Ce fut alors qu'il y écrivit
son "Histoire", publiée en 1555, et où il puise
dans la chronique, aujourd'hui perdue, de Rodrigo Lozano, soldat venu
au Pérou avec Hernando de Soto.
Relación de Chincha (1558)
Cette oeuvre peu littéraire, signée par Diego de
Ortega y Morejon et Fray Cristobal de Castro, deux bureaucrates
chargées de la rédiger, est une source précieuse
sur l'histoire de la côte centrale du Pérou. Les auteurs
y décrivent avec précision le système de
domination inca dans cette région : son administration, son
système d'impôts, la rigueur des châtiments, etc,
et permet d'apprécier comment, à partir d'un
"protectorat" basé sur les échanges commerciaux, les
Incas arrivaient peu à peu à étendre leur
domination absolue sur les peuples qu'ils avaient
subjugué.
Juan POLO DE ONDEGARDO : Tratado y
averiguacion sobre los errores y supersticiones de los indios
(1559)
Ce jurisconsulte arrivé au Pérou en 1544 avec le
vice-roi Blasco Nunez Vela participa activement aux guerres civiles
dans le camp loyaliste; il était, dit-on, capable de traverser
les rivières à la nage et tirait adroitement de
l'arquebuse.
Nommé corregidor (bailli) de Cuzco (1558-1561), il y fit un
peu d'archéologie, car il s'intéressait à la
culture indienne : il découvrit en 1559 les momies
dissimulées de plusieurs couples royaux Incas. Il fut ensuite
muté à La Plata (Sucre), puis le vice-roi Toledo, qui
l'appréciait, le ramena à Cuzco en 1571. Il n'y resta
qu'un an, peut-être pour lui avoir déplu en demandant la
grâce du dernier Inca, Tupac Amaru, et fut renvoyé
à La Plata où il mourut en laissant une grande fortune
(1575).
Il rédigea de nombreux rapports, tous d'un grand
intérêt, favorables aux indiens avant 1571, beaucoup
moins par la suite. Dans toute son ample, mais confuse production, il
faut mentionner : "Tratado y averiguacion sobre los errores y
supersticiones de los indios" (1559) - "Instuccion contra las
ceremonias y ritos que usan los indios conforme al tiempo de su
gentilidad" (1567) - "Informaciones acerca de la religion y gobierno
de los Incas", qui est l'un de ses rapports les plus fameux, fut
publié à Lima en 1916 : cette édition comprend
aussi le premier titre cité, ainsi que la "Relacion de los
fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar
a los indios sus fueros" (1571).
Hernando DE SANTILLAN : Relacion del
Origen, Descendencia, Politica y Gobierno de los Incas (1563)
Ce chroniqueur un peu monotone a fait de larges emprunts à
ses prédecesseurs, mais il se distingue par le ton
indigné avec lequel il décrit les exactions et les abus
exercés par les encomenderos . Ces dénonciations lui
valurent un procès et l'exil.
Girolamo BENZONI : Historia nel Nuovo
Mundo (1565)
Ce voyageur milanais parcourut à partir de 1541 l'Espagne,
les Canaries, Cuba, Saint Domingue, le Nicaragua et le Venezuela
avant de parvenir en1547 en Equateur où il séjourna
jusqu'en 1550, notamment à Quito, dans le but d'y faire
fortune. Son entreprise ne fut pas couronnée de succès,
puisqu'il en fut expulsé en tant qu'étranger par un
décret du vice-roi La Gasca.
Il erra ensuite en Amérique centrale et à Cuba.
Après avoir souffert plusieurs naufrages et autres
mésaventures, il retourna en Espagne en 1556.
En 1565 à Venise, il publia, en italien, son Historia nel
Nuovo Mundo où transparait toute sa rancoeur et son
ressentiment contre les Espagnols. L'ouvrage connut assez rapidement
une assez vaste diffusion et fut traduite en plusieurs langues...
sauf en espagnol. C'est en 1962 seulement que Raul Porras en fit
paraître une sélection dans son ouvrage "Los Cronistas
del Peru".
TITU
CUSI YUPANQUI : Relacion de la conquista del Peru y hechos del Inca
Manco II (1570)
Fils de Manco Inca et troisième Inca de Vilcabamba,
il assuma le pouvoir royal dans cette région lorsque son
frère aîné Sayri Tupac accepta la
conciliation du vice-roi Hurtado de Mendoza en 1557. A la mort de
Sayri Tupac, il se déclara en rébellion ouverte contre
les Espagnols et lança des incursion armées sur Cuzco
et Huamanga (Ayacucho). Après l'intervention du gouverneur
Lope Garcia de Castro, Titu Cusi fit envoyer deux mémoires aux
autorités, leur exposant ses plaintes à propos des
mauvais traitements endurés par son père et les
conditions qu'il posait pour abandonner ses positions. Après
pourparlers, il accepta que des missionaires viennent
catéchiser les indiens de Vilcabamba et reçut
lui-même le baptême, en 1568.
Avant de mourir d'une pneumonie (ou d'un empoisonnement), il avait
dicté en 1570 au frère augustin Marcos Garcia une
relation basée sur ses mémoires de la vie
impériale des Incas, qu'il adressa au gouverneur. Cette
"relation" fut publiée à Lima en 1916.
Pedro SARMIENTO DE GAMBOA : Historia
Indica (1572)
Ce Galicien, né à Pontevedra, fut d'avantage qu'un
simple aventurier : un véritable homme d'aventures, un grand
marin (amiral de la Garde des Indes) et un excellent géographe
qui avait fait des études universitaires. Sa vie est un roman
: il participa à la poursuite des Incas rebelles de
Vilcabamba, combattit sur mer contre Francis Drake, découvrit
les îles Salomon en 1567 et explora en 1579-1580 le
détroit de Magellan dont il fit le relevé. Il
était aussi astrologue et cabbaliste, ce qui lui valut des
démélés avec le Saint-Office de Lima en 1565,
pour avoir fabriqué et vendu des anneaux et amulettes
gravés d'inscriptions "magiques"...
Dévoué à la Couronne d'Espagne, il vaut sans
doute mieux que son épisode de chroniqueur à la solde
du vice-roi Toledo; les critiques actuels voyant en lui le
chef de file des historiens "tolédanistes",
c'est-à-dire défendant la vision imposée aux
écrivains du temps par ce vice-roi : celle d'un Pérou
asservi par la dynastie cruelle et immorale des Incas. Cette vue
très partiale est affirmée dans sa chronique "Historia
General llamada Indica", pour laquelle, selon ses dires, il
recueillit les témoignages de 42 seigneurs des anciens
lignages royaux. Il utilisa surtout le manuscrit de Juan de
Betanzos, que dut lui confier le vice-roi. Toutefois, il n'en fit
pas qu'une vulgaire copie, mais le réécrivit, le
dégraissa, y ajouta des informations et en corrigea d'autres
pour rendre son récit plus cohérent et plus
rationnel.
Malgré cela, son oeuvre reste entachée pour avoir
cédé à à la calomnie, et pour tout dire,
à la propagande. Son manuscrit resta enfoui jusqu'en 1893,
où il fut découvert dans une bibliothèque
universitaire allemande. Pietschmann la fit publier pour la
première fois en allemand, à Berlin en 1906.
Cristobal de MOLINA, dit "El Cusqueno" :
Relacion de las Fabulas y Ritos de los Incas (1573)
Arrivé en 1556 à Cuzco, il devint curé d'une
paroisse indigène, puis en 1570, visiteur
général, c'est-à-dire "extirpateur" de
l'idolâtrie. Il avait entretemps appris le quechua, qu'il
parlait à merveille. Il convainquit le dernier Inca, Tupac
Amaru, de se convertir avant son exécution (mai 1572).
Entre 1572 et 1573, il rédigea, sur l'ordre de son
évêque, sa chronique, ouvrage incomparable sur la
religion officielle, d'abord publié en anglais en 1873 par Sir
Clement Markham, puis en espagnol à Santiago du Chili en
1913.
VALERA, le Père
Blas : Historia de los Incas (1585)
Ce chroniqueur métis fut longtemps connu comme "le
Jésuite Anonyme" et son oeuvre est probablement
très diffusée à travers les fréquentes et
nombreuses citations qu'en fait Garcilaso
de la Vega dans ses
Comentarios Reales.
Né à Chachapoyas en 1551 et connaissant bien le
quechua, il fut envoyé en 1571 à Cuzco pour y accomplir
son labeur sacerdotal. Il reçut pour mission de compiler tout
ce qui avait trait à l'époque des Incas, travail qu'il
dut mener à bien entre 1580 et 1585. Vers la même
époque, il rédigea, avec le Père José
de Acosta, des cathéchismes en quechua et en aymara pour
l'instruction religieuse des Indiens. Il voyagea ensuite en Espagne,
à Cadix, pour superviser l'impression de son ouvrage. Mais par
la faute du sac de la ville par les Anglais (1596), il n'en resta que
quelques fragments qu'il remit entre les mains de Garcilaso de la
Vega, avant de mourir en 1597.
Il est l'auteur d'unVocabulaire quechua, également
perdu. On lui attribue aussi la chronique Las Costumbres antiguas
del Perú, publiée par M. Jimenez de la Espada en
1879.
3)
Chroniqueurs et moralistes du 17e siècle
Jose DE
ACOSTA : De Procuranda Indorum salute (1588) - Historia
Natural y Moral de las Indias (1590)
Ce chroniqueur est une des sources les plus précieuses sur
l'histoire et les civilisations anciennes du Pérou.
Poète, géographe, historien et savant, Alexandre de
Humboldt le qualifia plus tard de "Pline du Nouveau Monde".
Né à Medina del Campo, il entra dans la Compagnie de
Jésus en 1552 et arriva au Pérou en 1571. Il prit par
à une expédition dans la zone andine organisée
par le vice-roi Toledo, où son esprit curieux put
s'exercer dans l'observation de la nature et de la condition morale
et sociale des indiens. En 1580, il occupa la chaire de
théologie de l'université San Marcos et entreprit
d'écrire, avec l'aide du père Blas
de Valera entre autres, des
catéchismes en quechua et aymara pour l'instruction religieuse
des indiens.
La Doctrina cristiana y catecismo, publiée en 1584, est
le premier livre a avoir été imprimé au
Pérou. En 1585, il partit pour le Mexique puis rentra en
Espagne en 1588.
Son Historia natural y moral de las Indias fut publiée
à Séville en 1590 et fut longtemps
considérée comme une oeuvre fondamentale sur la
géographie, l'univers naturel et l'ethnographie de l'ancien
Pérou Il y fait preuve d'un esprit étonnament libre,
épris d'une méthode d'analyse presque humaniste.
Guaman
POMA DE AYALA : Nueva Cronica y Buen Gobierno (1600) Pour le fond, Guaman Poma n'a pas
tiré toutes ses informations des traditions andines,
loin de là : il a lu des historiens et les a souvent
non pas recopiés, mais reproduits dans son style. On
trouve ainsi chez lui des passages assez fréquents de
Murùa. Guaman Poma
présente son manuscrit au roi Philippe II (dessin
imaginaire)
Ce chroniqueur, sur lequel les historiens contemporains ne
tarissent pas d'éloges, naquit en 1535 dans la province de
Lucanas. Il avait un demi-frère religieux qui l'instruisit, si
bien qu'à partir de 1565, il se mit au service du père
Albornoz qui traquait dans sa province la secte millénariste
des Taqui Onqoy. Il travailla ensuite avec le frère Martin de
Murùa, aux alentours de 1590. Selon ses dires, il passa trente
ans sur son ouvrage, gros pavé de 1188 pages, dont 400
planches de dessins, réalisées par lui-même.
Ces illustrations, qui révèlent un talent brut, mais
certain, sont vivantes, évocatrices, pleines d'humour, et nous
comblent de renseignements sur la vie quotidienne au temps des Incas.
Leur immense intérêt réside aussi dans le fait
qu'elles constituent quasiment la seule source iconographique que
nous possédions sur cette époque de l'histoire du
Pérou. Quant au texte, son espagnol suit d'assez près
la syntaxe quechua.
A consulter, sur Guaman Poma, les pages qui luis sont
consacrées dans l'excellent site Cultura Peruana (en
espagnol) : http://www.magicperu.com/atlas/default65.htm
Ce manuscrit, l'auteur l'envoya sans complexe au roi
Philippe II en personne. On ne sait l'accueil qui lui fut
reservé, ni ce qu'il en advint par la suite; toujours
est-il que l'américaniste allemand Pietschman finit
par le découvrir en 1908 à la
Bibliothèque Royale de Copenhague.
Une édition française en fac-similé fut
publiée par Paul Rivet en 1936 à
l'Université de Paris ( Travaux et mémoires
de l'Institut d'Ethnologie , t. XXIII )
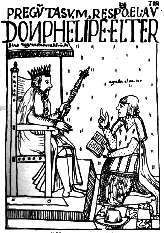
De son vrai nom Gomez Xuarez, il
naquit le 12 avril 1539 à Cuzco, fils naturel de
Sebastian Garcilaso de la Vega, d'illustre famille, et
d'Isabel Chimpu Ocllo Xuarez, fille du prince Huallpa Tupac,
frère entier de l'Inca Huayna Capac. Il quitta le
Pérou en janvier 1560, après la mort de son
père, et n'y revint jamais; il projeta un retour en
juin 1563, mais rata le bateau et y renonça. Les Commentarios Reales de los
Incas qui s'arrêtent à la victoire d'
Atahualpa sur Huascar (Huascar étant décrit
comme l'Inca légitime et Atahualpa comme un
usurpateur sanguinaire), furent édités
à Lisbonne en 1609 et son Historia General del
Peru (la conquête et les guerres civiles)
à Cordoue en 1617. Garcilaso était mort depuis
le 23 avril 1916.
Inca
GARCILASO DE LA VEGA : Commentaires Royaux sur le Pérou des
Incas (1609) . Dernière édition française :
François Maspero/La Découverte, Paris 1982 (3
vol.).
Il rumina son oeuvre sur le Pérou jusqu'en 1590,
où il entreprit de la rédiger, tout en
terminant La Florida del Inca (la conquête de
la Floride par Hernando de Soto, parue en 1605). Il
prétend avoir puisé pour beaucoup dans ses
souvenirs de jeunesse, mais en réalité, il
fait de nombreux emprunts à d'autres historiens,
parfois cités de façon tendancieuse, et
extrapole largement la chronique du père
Blas de
Valera,
référence qu'il cite à de nombreuses
reprises.

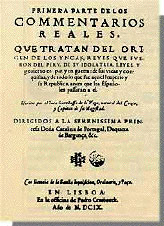
Son ouvrage est d'une haute tenue littéraire, mais on
comprend que l'auteur soit partial. Parce que son oeuvre fut
rapidement connue et très largement répandue,
il figura longtemps comme le seul historien du Pérou
ancien, et fut porté aux nues à tel point
qu'on le surnomma "l'Hérodote des Incas". En
réaction, ce succès finit par provoquer
à son encontre une mode "antigarcilasiste" tout aussi
excessive. Aujourd'hui, les historiens soucieux d
'objectivité le consultent avec plaisir, mais aussi
avec prudence.
Fray Martin DE MURUA :
Historia General del Perú, Origen y Descendencia de los Incas
(1613). Arrivé avant 1560 à Cuzco, ce frère
de l'ordre de La Merced eut en charge diverses paroisses dans le
Haut-Pérou, notamment à Puno et à Aymaraes, et y
apprit le quechua et l'aymara pour mener à bien son travail
évangélique. Il s'y disputa avec Guaman Poma de
Ayala, qui l'accusait d'être un curé abusif et
dissolu et le représenta comme tel dans l'un des dessins de sa
chronique.
A partir de 1590, Murua se partagea entre Arequipa et Cuzco,
où il s'établit en 1606 et rédigea sa version
définitive de l' "Histoire Générale du
Pérou" en s'inspirant beaucoup de Sarmiento de Gamboa;
il l'acheva le 1er janvier 1613 à la Plata (Sucre), en
rentrant en Espagne par le chemin de Buenos-Aires. Il mourut
après mai 1916 et son manuscrit, qu'il n'avait pas
réussi à faire publier, fut enfoui dans une
bibliothèque de Salamanque. Volé par Joseph Bonaparte,
pris par Wellington avec les bagages du roi, ce manuscrit fut
retrouvé en 1951 dans une bibliothèque anglaise.
Chronique du Jésuite Anonyme
(1615)
On a vu en son auteur le père Blas
de Valera. Les experts en
discutèrent avec des arguments variés et subtils. Sans
doute ne leur paraissait-il pas suffisant que la "Relation des
coutumes antiques des naturels du Pérou" fût
datée de1615 alors que le père Valera était mort
depuis 1598. L'identification plus récente avec le père
Luis Lopez n'est pas plus heureuse, l'évêque de Quito
étant décédé en 1588. Comme Valera, comme
Garcilaso, ce religieux était un métis qui voyait dans
les Incas de nobles et irréprochables proto-chrétiens.
Il est à prendre avec de grandes précautions.
Juan de SANTACRUZ PACHACUTI : Relacion de
antigüedades deste reyno del Pirú
(1615-1620)
Comme Guaman Poma, ce chroniqueur est d'origine indigène : il
descendait d'un lignage de nobles Collaguas (au Sud-Ouest du
Vilcanota).
Confit en dévotion, il prétend que son
arrière-grand-père fut le premier baptisé de
l'Empire, ce qui ne l'empêche pas de connaître par coeur
les prières et les rites païens. On ne sait rien d'autre
de lui. Tout l'intêrét de sa chronique réside
dans la transcription des poèmes et chants épiques
quechuas de la dynastie Inca. Elle n'est pas sans valeur, quoique
tardive et donc entachée de légendes; elle doit
quelques passages à Martin
de Murua.
Anello OLIVA : Historia del Reino y
Provincias del Peru y Vida de los varones insignes de la
Compaña de Jesus (1631). Edition moderne dans la
collection Clasicos Peruanos (dirigée par Franklin Pease),
Pontifica Universidad Catolica del Peru, Lima 1998.
Ce jésuite napolitain vécut au Pérou dans la
première moitié du 17e siècle. Missionnaire
actif et érudit, il s'intéressait aux vestiges
laissés par les Incas. Ses informations ne sont pas de
première main : elles proviennent d'un curé qui les
détenait d'un secrétaire de l'Inca Huascar. On y
perçoit aussi l'influence d'un autre jésuite, le
Père Blas Valera. L'un des aspects les plus surprenants de sa
chronique est qu'il prête aux Incas une origine
quiténienne, ce qui est le comble pour des sources proches du
lignage royal de Cuzco.
Francisco de AVILA : Hombres y dioses de
Huarochiri (vers 1640)
Ce curé doctrinaire de l'ordre des Jésuites passa
à la postérité historique avec la publication,
par José-Maria Arguedas en 1950, d'une compilation de ses
oeuvres que le grand romancier indigéniste intitula : "Hombres
y Dioses de Huarochiri". Francisco de Avila avait reçu le
grade de docteur en Théologie et en Droit à
l'Université de San Marcos. Il voyagea ensuite à
Chuquisaca (dans l'actuelle Bolivie). De retour dans les evirons de
Lima, il prit en charge la paroisse de Huarochiri, où il se
mit à catéchiser les Indiens et à extirper
l'idôlatie, dans leur propre langue, le quechua, qu'il avait
appris et étudié lors de son périple.
En même temps, il rédigea un Tratado y relacion de
errores, falsos Dioses y otras supersticiones y ritos diabolicos
, puis une Relacion de las Idolatrias En 1646, il fit publier
son dernier ouvrage : Tratado de los Evangelios, directement
écrit en quechua, où il a laissé de nombreux
renseignements autobiographiques.
L'oeuvre de Francisco de Avila est d'un grand intérêt
historique et ethnologique. Elle a été
étudiée notamment par Julio C. Tello et Luis E.
Valcarcel. Il semble qu'il ait été, à son
époque, le meilleur spécialiste de la langue quechua.
Son plus fameux sermon est dirigé contre Pariaccaca et
Chaupinamoc, qui étaient les dieux
vénérés par les indigènes de la
région de Huarochiri. Hélas, il est probable que les
écrits et les paroles ne lui suffisant pas, son zèle
lui fait commettre des actes excessifs. Toujours est-il que les
Indiens de sa paroisse portèrent à Lima une
dénonciation contre ses abus qui devaient être assez
graves puisque, sur l'ordre du Vice-roi, il fut emprisonné
pendant deux ans.
Revenu en grâce, il fut finalement nommé "Visitador" des
idôlatires dans les provinces de Huarochiri et de Jauja,
où il mena à nouveau une grande campagne d'extirpation
qui ne dut pas être douce, pour que Guaman
Poma de Ayala la dénonce
plus tard dans sa chronique.
Antonio DE LEON PINELO : El Paraiso en el
Nuevo Mundo (1650) - Publié par Raul Porras
Barrenechea, Lima 1943.
Singulier mélange de fantastique et d'érudition, la
chronique de Pinelo tend à prouver que le paradis terrestre se
trouverait au Nouveau Monde, en pleine forêt amazonienne, dans
un cercle de neuf degrés, gardé par des volcans. Il
assure en outre que les quatre rivières des saintes
écritures sont l'Amazone, le Rio de la Plata,
l'Orénoque et le Rio Magdalena! L'Homme serait apparu pour la
première fois en Amérique du Sud; ensuite, avec l'arche
de Noé, il serait passé de la côte centrale du
Pérou au continent asiatique pour de là, propager
l'espèce humaine en Occident. Après quoi, il serait
revenu à ses origines.
Dans ses descriptions de la nature, de la faune et de la flore du
Pérou, Pinelo prend les mêmes libertés qu'avec
l'interprétation de la Bible : il n'est question que
d'amazones, de sirènes, de serpents ailés, d'arbres
magiques qui emprisonnent ceux qui se reposent à leur ombre,
de montagnes de sel qui avancent toutes seules, etc.
Fernando DE MONTESINOS : Memorias
Antiguas, Historiales y Politicas del Peru (vers 1650).
Jésuite peu édifiant et peu charitable, il vécut
au Pérou à partir de 1628 ou 1629. Animé par un
goût d'aventurier et une curiosité vorace, il sillona le
Pérou et la Bolivie, allant jusqu'à traverser 60 fois
les Andes, en tant que membre visiteur de la Real Audiencia de Lima.
En 1637, il organisa une expédition dans la forêt
amazonienne à la recherche de la légendaire cité
de Paititi, que l'on croyait être l'El Dorado. Au cours de tous
ses voyages, il recueillit un peu partout nombre d'informations et
collecta tous les papiers de son ordre.
Malheureusement, il nous offre dans ses "Mémoires" un
salmigondis indigeste où s'enrôlent sous la
bannière inca des souverains de Huari, du royaume Chimú
ou d'autres cultures antérieures. Il rédigea
également des Annales du Pérou (publiées
en 1906) qui couvrent la période allant de la conquête
du Darien(!) jusqu'en 1642, et une Historia del Paititi
demeurée inédite. Ce jésuite très
prosélyte commit également plusiers petits ouvrages sur
un sujet qui semblait lui tenir à coeur: la recherche des
minerais et l'exploitation des métaux
précieux.
La première traduction en anglais fut publiée par Philip Ainsworth Means, avec une introduction de Clements R. Markham, London 1920.
Bernabé COBO : Historia del Nuevo
Mundo (1653)
Né en 1580, il avait seize ans losqu'il passa les mers, en
1596, et en 1601, il entra au noviciat jésuite de Lima avant
d'être ordonné prêtre en 1612 à Cuzco.
Nommé au collège jésuite de Juli, il devint
missionnaire dans la région du lac Titicaca et en Bolivie,
où il alla visiter l'Audience de Charcas. Infatigable, il
parcourut tout le Pérou, puis se rendit au Mexique en 1629
avant de revenir à Lima vers 1642, où il devait mourir
en 1657.
Il consacra en tout près de quarante années à la
rédaction de sa monumentale Historia del Nuevo Mundo,
ouvrage encyclopédique en trois parties et quarante-trois
livres! Mais on en connaît seulement la première partie,
imprimée à Séville entre 1890 et 1893 en quatre
volumes. Les deux premiers tomes, travail original et
précieux, répertorient et décrivent la flore du
pays. Les deux autres, qui couvrent tous les aspects de l'empire des
Incas, constituent un recueil de morceaux choisis sans mention
d'auteurs. Cobo est cependant utile, car chez lui on trouve tout, et
de plus, il a reécrit en espagnol limpide le charabia de
certains de ses prédécesseurs, tout en enrichissant sa
copie de détails intéressants recueillis ici et
là.
(La plupart de ces notices biographiques sont issues de l'ouvrage de Roberte MANCEAU : Atawallpa ou la dérision du destin, Ed. Peuples du Monde, Paris, 1992).
Sommaire / Introduction / Archéologie / Pages du Dictionnaire A, B, C... / Bibliographie