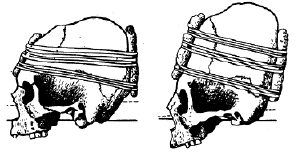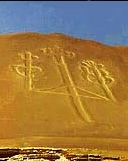|

|
...dans
les sables de PARACAS
|
A 260
km au Sud de Lima, non loin du port de Pisco, la presqu'île
de Paracas, aujourd'hui classée réserve naturelle,
fut habitée à partir de 3000 ans avant J.-C. et,
grâce à la sécheresse du climat, a
merveilleusement conservé les corps et les objets qui furent
enfouis dans son sol. C'est à Julio
C. Tello
que revient l'honneur d'avoir le premier entrepris des fouilles
systématiques en 1925, qui aboutirent à la
découverte d'un grand nombre de chambres funéraires
souterraines, creusées de main d'homme, parmi lesquelles une
extraordinaire nécropole enclose d'un mur, qui contenait un
ensemble de 429 fardos funéraires. Chacune de
ces momies était "emballée" dans des ballots de coton
recouverts de pièces de tissu aux motifs et aux couleurs d'une
grande richesse.

Momies de
Paracas Necropolis gisant dans la pampa de Nazca,
après le passage des Huaqueros, ou pilleurs de tombes (photo
A. Baldet)
Pendant la première moitié du
IIIe millénaire, les habitants de Paracas enterrèrent
leurs morts en position fléchie, vêtus de nattes, de
filets et de peaux, en déposant à leurs
côtés des flèches en bois dur, des bâtons,
des colliers de perles, des petites bourses en corde. Ils ne
connaissaient ni la céramique, ni le coton et se servaient de
roseaux, de fibres de cactus et de liane pour se vêtir; la
laine filée n'était pas utilisée pour les
vêtements. Cette population, qui est classée parmi les
"Premiers agriculteurs" est connue sous le nom d'Homme de Cabeza
Larga.
Avec l'influence de la civilisation de
Chavin, apparaissent la poterie et le maïs. A une date
légèrement antérieure à la fin de
Chavin
, vers 650 avant J.-C., commence à se développer, sur
la côte centrale et dans les vallées
côtières, une culture dite de Paracas, dont le foyer
principal n'est pas connu. Selon les archéologues qui
l'étudièrent après Tello, elle peut être
divisée en quatre périodes principales :
Paracas-Ocucaje, dit encore Ocucaje-Ica ou Paracas Inital
(800-500 avant J.-C.), Paracas-Cavernas (500 à 300
avant J.-C.), lesquelles appartiennent à la Période
Formative, ensuite Paracas-Necropolis (300-200 avant J.-C.) et
enfin Proto-Nazca (100 avant J.-C. jusqu'à environ 200
après J.-C.). Après quoi elle prend le nom de culture
de Nazca
, et ce jusqu'en 900 de notre ère, date de l'intrusion,
sur la côte, de la culture andine de Tiahuanaco-Huari
.
|
Qu'est-ce
qu'un"Fardo funéraire"?
Il s'agit d'une sorte de sarcophage de toile
enveloppant généralement une momie (ou
plusieurs), ou un simple "enterrement symbolique". Le fardo
est composé d"un nombre plus ou moins grand de
pièces de toile de coton blanc, de tuniques (coton ou
laine teints), peintes ou brodées, d'unkus en
plumes de perroquets, et de filets de totora. Certains sont
surmontés de "fausses têtes" (Lima, Ancon) ou
de masques de bois taillé. Le fardo
péruvien contient en général des
bourses à coca et graines magiques, des épis
de maïs, des feuilles de pacae, parfois une peu de
bête (renard), un chien ou un oiseau momifié,
des bijoux et ornements, flûtes d'os ou de roseau,
etc.
|

|
La
séquence "PARACAS-Cavernas"
Mises à jour par Tello, les tombes du type de Cavernas
sont des chambres souterraines en forme de coupole taillées
dans le roc, quelquefois jusqu'à plus de 8 mètres de
profondeur, dans lesquelles on parvient par un étroit puits
vertical muni de marches. Au-dessus de la chambre se trouve une
antichambre plus large dont les parois sont revêtues de
pierres. Ce qui fait souvent dire que ces sépultures ont la
forme de bouteilles à long col.
Ces tombes renferment de nombreuses momies (l'une d'elles en
contenait cinquante-cinq), aux genoux ramenés sur la poitrine
et enveloppées dans des tissus de toile ou de gaze,
décorés tout au plus par des bandes de deux couleurs.
La plupart des crânes des momies révèlent
l'existence de déformations (aplatissement artificiel
des crânes) et de trépanations extensives et
quelquefois répétées. On ignore les raisons de
cette dernière coutume. Certains y voient la
conséquence des blessures faites par les massues de pierre;
cette explication n'a pas été retenue, car on trouve en
de nombreuses régions ce type de massue, alors que la
trépanation y est inconnue ou très rarement
pratiquée. Il est probable qu'il s'agit d'une pratique qui
avait une signification religieuse. Quelle qu'en ait
été la raison, les patients survivaient à
l'opération ou aux opérations.
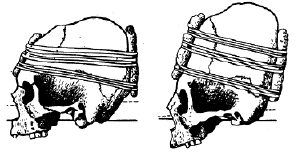
Exemples de déformations
crâniennes (Paracas-Cavernas)
La
séquence "PARACAS-Necropolis"
Les tombes de la phase de Paracas-Necropolis sont des fosses
rectangulaires de dimensions variées, non recouvertes, qui
étaient remplies de momies empaquetées et de sable.
Plus de quatre cents momies ont été re trouvées
ici. Chaque corps avait les genous ramenés sur la poitrine,
était quelquefois déposé dans un panier, et
enveloppé de plusieurs épaisseurs de tissus d'une
remarquable facture. Nombre de ces tissus sont couverts de broderies
aux couleurs vives, rouges, bleues, jaunes, vertes, brunes, d'autres
encore, qui représentent des figures grotesques, des monstres,
des oiseaux, des animaux, disposés avec beaucoup d'art. Il y a
là des manteaux, des chemises, des pagnes, des turbans; chaque
momie est souvent enveloppée dans plusieurs vêtements,
tous neufs et apparemment confectionnés spécialement
pour les funérailles. Ce qui distingue la nécropole de
Paracas des autres sépultures péruviennes, qui
utilisent des techniques de tissage telles que la tapisserie et le
brocart, c'est l'usage de la broderie comme ornementation. De
nombreux musées possèdent des fragments de ces tissus
qui donnent une idée assez bonne de leurs couleurs et de leur
ornementation, mais les corps qui sont exposés au musée
de Lima, revêtus de tous leurs vêtements, forment un
spectacle inoubliable. Les crânes de ces momies sont
artificiellement déformés, allongés et
rétrécis, ce en quoi ils diffèrent de Cavernas.
La trépanation n'apparaît que rarement. La poterie
ressemble, quant aux formes, à celle de Cavernas, mais elle
est généralement moins massive et de couleur
crème ou brune.
El
CANDELABRO (le Candélabre)
|
Dominant la baie de Paracas, ce
gigantesque géoglyphe qui appartient au
système des tracés mystérieux (comme
les lignes de Nazca), a cette particularité
d'être creusé dans le sable meuble d'une grande
dune. Sa longueur est de 183 m. La transversale qui est
censée supporter les deux branches verticales passe
à 100 m exactement du sommet.
La largeur du fossé central est de 5m de bords
à bords intérieurs et de 6 m d'axe à
axe du bourrelet; sa profondeur oscille entre 50 et 60 cm.
Le "Candélabre" est orienté Nord-Ouest -
Sud-Est.
On ignore à quelle époque, et par quelle
culture il fut tracé dans le sable, et s'il avait ou
non un rapport avec des observations astronomiques. Les
tenants des élucubrations sur les "pistes
d'atterrissage" qu'auraient constitué les lignes de
Nazca, s'empressent de lui faire jouer le rôle de
"balise spatiale" destinée à guider les
"astronautes". D'autres, plus prosaïques, pensent qu'il
ne s'agit pas d'un vestige précolombien, mais d'un
signe de ralliement dessiné et utilisé par des
flibustiers au 16e ou au 17e siècle…
|
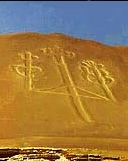
|
Pour visiter le site de la
Reserva
Nacional de Paracas
(en espagnol) :
http://ekeko.rcp.net.pe/peru/ica/paracas.html
Sommaire
/ Introduction
/ Archéologie
/ Pages du Dictionnaire
A, B, C... / Bibliographie