![]()
Maïs
Entre tous les produits alimentaires de l'ancien Pérou, le
maïs, pour sa grande valeur nutritive et
énergétique, tient une place
prépondérante. Il peut être cultivé sur
les plateaux côtiers jusque dans la sierra, même
au-dessus de 3500 m d'altitude.
Du maïs, sara en quechua, on connaît
plusieurs variétés péruviennes qui se
distinguent par la taille et la forme de ses fanes (mazorca en
espagnol), par la couleur de l'épi (choclo) : blanc,
jaune, violet, rougeâtre, et la consistance de ses grains.
Il était consommé sous bien des formes : en mote
(les grains bouillis et passés dans la cendre), en
cancha (grillé), en chochoca (purée de
maïs bouilli).
A base de maïs fermenté, on préparait la boisson
dénommée Asua en quechua, que l'on
dénomma ensuite chicha , ce mot centro-américain
ayant été introduit au Pérou par les Espagnols.
La chicha était par excellence la boisson servie dans les
fêtes, dans les cultes et pendant les cérémonies
agraires.
La humita était, pour ainsi dire le "pain" des incas.
Elle était obtenue en broyant au mortier des grains tendres de
maïs blanc. La farine ainsi obtenue, mélangée avec
de l'eau, formait une pâte que l'on enveloppait dans les
feuilles (Pancas ) de la plante et que l'on faisait cuire au
bain-marie. Les fameux tamales étaient
préparés de la même façon, mais avec de la
farine de maïs rouge. Tous ces mets sont encore largement
consommés aujourd'hui au Pérou. Certaines
variétés d' humitas, celles qui par exemple,
étaient préparées pour les festivités
religieuses, se voyaient mélangées à du sang
d'animaux sacrifiés à des fins magiques : cette
préparation était appellée sanku
.
|
Maranga-Lima |
 La "Vénus de Lima" (statuette en bois) |
Marka
Dans les deux principales langues des Andes, le quechua et
l'aymara, ce mot marka a le même sens, défini par
Louis Baudin : "le village et son territoire". On le retrouve
d'ailleurs en tant que suffixe dans de nombreux toponymes du
Pérou préhispanique, mais avec le sens de "ville ou
village fortifié" : Marka Huamacuco, Pampamarca,
etc.
Mascapaycha
Frange de tissu rouge qui pendait de la coiffe de l'Inca et
recouvrait la partie supérieure de son visage lors de ses
apparitions publiques ou de ses sorties en litière.
Mate
Nom scientifique : Lagenaria vulgaris . Fruit sec ou
calebasse. Evidée et partagée en deux
horizontalement, forme le maté qui sert au Pérou,
depuis l'antiquité, de plat, assiette, bol, et même
bouteille ou boîte, selon la forme.
L'artisanat local fournit encore de magnifiques mates burilados
(burinés) ou pyrogravés, très richement
travaillés et ornés d'une foule de petites
scènes. Mais les plus anciennes pièces sont de
véritables oeuvres d'art.
MATEO SALADO
Nom donné aux vestiges, aujourd'hui assez
dégradés, d'un ensemble de pyramides de la
culture Maranga-Lima qui subsistent encore à
l'Ouest du centre de Lima. On peut s'en faire une
idée depuis le Parque de la Bandera, grand rond-point
en limite des districts de Lima,
Breña et Pueblo Libre.
Les constructions, étagées sur des terrasses,
sont faites en gros blocs d'adobes et présentent des
restes d'habitations dont on suppose qu'elles servirent de
palais au représentant de l'Inca, lorsque la
vallée du Rimac passa sous son contrôle.
Curieusement, le nom de ce complexe archéologique est
dû à un français, Mathieu Salade.
Venu à Lima au 16e siècle, il s'établit
dans les parages et y commença une campagne de
fouilles et d'excavations qui attira sur lui les foudres du
tribunal de la Sainte Inquisition de Lima qui le
déclara hérétique et le condamna au
bûcher en 1573.

Médecine et chirurgie
Au temps des Incas, et probablement parmi les civilisations qui
les ont précédé, la médecine empirique
fut pratiquée, en relation étroite avec les pratiques
magiques et religieuses. Les maladies étaient suposées
avoir été causées par une "frayeur" (susto
, en espagnol), c'est-à-dire par une brusque
séparation de l'âme et du corps, ou alors par un
péché, ou bien par un maléfice dû à
l'action d'un sorcier.
Le "soigneur", était aussi un devin (le mot espagnol est
curandero ) car il devait d'abord diagnostiquer la cause du
mal avant de proposer les remèdes appropriés, à
base de rituels magiques et d'herbes médicinales. On
pratiquait également, depuis des temps très
reculés, des interventions chirurgicales qui aujourd'hui
encore forcent l'admiration, parmi lesquelles les fameuses
trépanations crâniennes dont on a retrouvé de
nombreuses traces sur des squelettes et des momies. Ces
trépanations étaient pratiquées pour
éliminer les fragments d'os brisés suite à des
contusions accidentelles, des blessures de guerre (coups de massue
par exemple) ou bien pour libérer le patient des mauvais
esprits dans le cas des maladies mentales.
Les instruments chirurgicaux en vigueur étaient - comme pour les sacrifices - le classique tumi , ou couteau de cuivre à la lame arrondie, des tranchets d'obsidienne, des aiguilles et des pinces en os. Les pansements de coton et la gaze étaient connus depuis l'époque de Paracas. Quant à la coca, elle constituait un anesthésiant idéal, à laquelle on devait adjoindre la chicha fermentée, absorbée en grande quantité.
Métallurgie et métaux chez
les Incas Le travail des métaux
était destiné plus directement à la
décoration qu'à des fins utilitaires. Les
ateliers fournissaient. en premier lieu. les longues plaques
qui devaient recouvrir en partie les murs des temples et des
palais. Les orfèvres fabriquaient les bijoux
réservés exclusivement à l'empereur et
aux hauts dignitaires : pendentifs. bracelets et surtout
disques fixés aux oreilles des grands. A cela
s'ajoutaient de nombreux objets de culte, parmi lesquels le
fameux tumi, couteau de sacrifice en forme de
demi-lune, déjà à l'honneur à
l'époque Mochica.
Les Incas ne connaissaient pas le fer. Ils utilisèrent
donc la pierre et le cuivre pour fabriquer leurs outils, alliant ce
dernier à l'étain pour obtenir le bronze. Ils
acquérirent cependant une maitrise excellente du travail des
métaux précieux tels que l'or, l'argent et le platine.
Ce dernier n'était guère connu en Europe et ne le fut
qu'à partir de 1730.
Les pépites étaient extraites du lit des
rivières. martelees et converties en feuilles pouvant
être façonnées. On dégageait aussi de l'or
de mines à ciel ouvert ou de galeries peu profondes. Les
Indiens creusaient la terre au moyen de pics munis de bois de cerfs
ou encore de manches à pointes de cuivre. Une fois extrait des
filons, le minerai était fondu dans des fours percés
d'ouvertures laissant passer l'air.
Si les mines d'or et d'argent appartenaient exclusivement
à l'Inca. c'étaient les curacas qui se
trouvaient chargés de veiller à leur
exploitation. Les gisements étaient sous surveillance
incessante. de peur que ne fût volé quelque
déchet des précieux métaux.
A leur arrivée, les Espagnols découvrirent
avec étonnement un étrange "or blanc", alliage
de platine. d'or et d'argent. Obtenu à des fins
religieuses. ce métal était
réservé au temple de la Lune, dont il avait la
couleur. Les Espagnols racontèrent en avoir
trouvé une plaque de plus de huit mètres de
long.
Le gisement le plus important était celui de
Potosi, à 4800 m d'altitude. Ce furent surtout
les Espagnols qui l'exploitèrent, suivant le
système de l'encomienda, reprenant à
leur compte les structures mises en place par les Incas. Le
travail des mineurs, qui n'avait jamais été
facile, devint, après la conquête, un long et
terrible calvaire qui débouchait
inévitablement sur la mort.

Atelier d'orfèvrerie (gravure du 17e
s.)
Mita
Mot quechua signifiant le "tour", c'est-à-dire la
corvée, dûe au service du Soleil ou à celui de
l'Inca. Les paysans recrutés pour la corvée furent
dénommés "mitayos"par les Espagnols qui
détournèrent cet usage à leur profit dans le
terrible système colonial de l'encomienda.
Mitimaes (ou
Mitmaq)
Groupe de familles, parfois tout un
ayllu,
que les Incas déplaçaient soit pour coloniser des
régions désertes et nouvellement conquises, soit en
manière de punition. (De là viendrait le mot
français "micmac").
MORAY
L'ensemble de ces ruines, situées dans la province
d'Urubamba à 40 km environ au Nord-Ouest de Cuzco,
s'élève à 3437 m d'altitude. Ces restes
archéologiques mis à jour en 1930 par
l'expédition Shippe-Johnson, sont constitués de quatre
groupes de constructions circulaires concentriques,
s'élargissant vers le haut. Chacun de ces cercles comprend une
terrasse, celle-ci superposée à une autre, formant des
anneaux de plus en plus grands à mesure que l'on atteint la
superficie. L'ensemble de ces terre-pleins, soutenus par des murs
lithiques de type cellulaire, devaient être irrigués par
un système de canaux appropriés. Chaque groupe compte
jusqu'à sept murs de soutènement. L'ensemble atteint
une profondeur de 150 m.
Ces réalisations durent servir, à l'époque inca,
de jardin d'acclimatation, sorte de centre d'étude agronomique
avant la lettre, où le but recherché était
d'améliorer les plantes cultivées dans tout l'empire.
Les deux petites habitations, au fond du second groupe,
étaient peut-être la demeure des botanistes ou des
gardiens de ces "jardins suspendus".
MOXEKE
Site archéologique situé sur la rive droite du rio
Casma, peu avant le confluent de ce dernier avec le rio Sechin
(côte Nord du Pérou). Appartenant à la
Période Formative (à partir de 1500 avant J.-C), ce
temple de vastes proportions est une construction pyramidale
comprenant sept plateformes superposées dont le sommet devait
être couronné de deux adoratoires
surélevés, symétriquement disposés l'un
à côté de l'autre.
Il fut exploré et décrit par Middendorf au
siècle dernier, mais il fallut attendre l'expédition
dirigée par J-C Tello en 1930, pour que soient mis au jour,
sur la Troisième plateforme de la façade, les niches
renfermant des reliefs de terre séchée recouverts
d'argile, des adobes de pierre et de boue séchée
coniques ornées de représentations de félins, de
serpents et d'êtres humains dans le style de Chavin, peints en
jaune, blanc, noir et rouge.
Sur les six grandes idoles antropomorphes, quatre sont hélas
très détériorées, les deux restantes, en
meilleur état, sont en fait deux têtes isolées
encastrées dans des niches de plus petites dimensions, assez
semblables dans leur disposition aux têtes de félins de
style chavinoïde d'un site peu éloigné, celui de
Caballo Muerto.
Musique et poésie
Ces deux arts - intimement liés - remontant à une
tradition déjà millénaire, étaient
abondamment pratiqués au temps des incas, non seulement
à l'occasion des fêtes du calendrier, mais aussi
à l'occasion des travaux collectifs et des
récoltes.
Parmi les instruments de musique purement précolombiens, on
relève les grelots (cascabeles en espagnol, ou
shacchas en quechua) avec lesquels on donnait le rythme
pendant les danses; ils étaient généralement
placés sous les genoux des danseurs et étaient faits de
métal, d'écorce ou de pépins de fruits. Dans la
famille des instruments à air, on trouvait la trompe, la flute
de pan ou antara, faite de tubes de roseaux de longueurs
différentes, la flûte à encoche ou kena,
en bois ou en os; ainsi que le fameux pututo, sorte de conque
faite avec un gros escargot de mer. Les instruments à
percussion étaient surtout des tambours, faits en cuir de lama
et parfois, de peau humaine extraite du corps d'un ennemi vaincu. Les
petits tambourins, ou tinyas , étaient surtout
utilisés pour rythmer les travaux des champs.
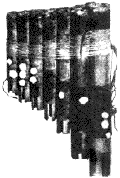

Les mélodies indiennes, que l'on peut encore entendre dans toute leur pureté dans certaines régions des Andes, ne comportaient que des gammes pentatoniques, sans harmonisation ni modulation. Plus tard, avec le métissage espagnol, s'est ajouté au vieux modes à cinq tons des valeurs de l'échelle européenne - accords et cadences en majeur ou mineur. Un instrument aujourd'hui très répandu chez les indiens comme chez les métis, est le charango, sorte de mandoline à cinq cordes tendues sur la carapace d'un tatou. Il est postérieur à la Conquête, car les instruments à corde étaient inconnus dans le Pérou préhispanique.
La poésie Inca, en dépit du manque d'écriture, est restée vivace pendant des siècles et a été recompilée par les chroniqueurs. C'est une poésie épique et légendaire, dont les thèmes principaux sont fournis par la mythologie des origines incaïques, ou par les hauts faits des souverains. De la poésie quechua, a été conservé le fameux drame Ollantay, d'origine certainement préhispanique, mais qui fut probablement recopié et amendé à l'époque de la Colonie. Dans la veine sentimentale et mélancolique, un genre, le yaravi, subsite toujours aujourd'hui dans les Andes, de même que le huayno, d'inspiration plus joyeuse. L'un est l'autre sont toujours accompagnés de musique et de danses.