


|
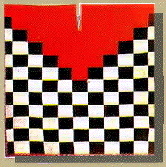
|
Uncu
Pièce du vêtement traditionnel inca. Il
s'agissait d'une chemise, ou tunique sans manches, en tissu
ou en laine de lama, qui est à l'origine du poncho.
Celles des artisans et paysans se devaient d'être
simple et sans décoration. Les fonctionnaires et les
dignitaires avaient droit à des motifs et les
militaires à la fameuse tunique à damiers
noire et blanche (ci contre).
Pour les nobles et la famille de l'Inca, l'uncu devenait une
somptueuse pièce d'étoffe couverte de
broderies : le fameux tocapo.
|
URCOS
Petit chef-lieu de province qui marque le passage entre la
région de Cuzco et la haute-vallée du rio Vilcanota.
Les Incas y avaient édifié un tambo
, réputé très important, mais qui a
complètement disparu.
Dans ses environs se trouve le fameux lac Urcos, petit lac rond et
profond qui occupe un ancien cratère de volcan. Selon la
tradition, c'est dans ce lac qu'aurait été jetée
la grande chaîne en or de l'Inca Huascar
à l'arrivée des Espagnols devant Cuzco. Cette
chaîne avait été faite pour
célébrer la naissance de Huascar, fils de Huayna Capac
et rival infortuné d'Atahualpa.
Aucun Espagnol ne l'avait jamais vue, mais les Indiens disaient que
"chaque chaînon était aussi gros qu'un poing d'homme et
que deux cents hommes n'auraient pas suffi à la porter
".
Uros : voir page
Le
Lac Titicaca et la civilisation de Tiahuanaco
Vêtements
L'Etat inca s'occupait de fournir des vêtements
à tout le peuple. Strictement réglementé, simple
et uniforme. L'habillement ne laissait aucune place à la
coquetterie et à l'imagination. Il était purement
utilitaire. Les indiens, d'autre part, n'avaient pas peur de la
nudité et se couvraient essentiellement pour se
protéger du froid. Jambes et bras restaient à l'air,
souvent glacé, de la Cordillère.
L'homme portait une sorte de chemise sans manches, blanche,
l'uncu, un pagne, le huara, fait d'une bande
d'étoffe passant entre les jambes et retenue à la
taille par un cordon de laine. Il jetait sur ses épaules une
cape ou un poncho brun. La femme, quant à elle, revêtait
une longue tunique ouverte sur les côtés pour lui
permettre de marcher plus aisément, l' anaku,
ajustée à la taille par une ceinture. Son costume
était également complété par un
châle de laine tissée, le Iliclla, retenu sur la
poitrine par une grande épingle ou tupo.
Les paysans travaillaient pieds nus. Ce n'est qu'en cas de voyage ou
lorsqu'ils revêtaient un habit de fête qu'ils mettaient
des sandales, les ojotas, faites avec la partie la plus
épaisse de la peau des lamas. La semelle cependant ne
protégeait que la plante du pied. Elle laissait libre les
orteils, grâce auxquels l'Indien se rattrapait aux
aspérités du terrain quand il glissait. La sandale
était attachée au pied par un cordon de
laine.
|
VICUS
(céramique de)
C'est en 1963, à la faveur d'un article de
journal qui se faisait l'écho du pillage de
près de 1500 tombes pré-incaïques
situées sur les pentes du Cerro Vicús,
près de Piura dans le Nord du Pérou, que l'on
découvrit l'existence d'une culture de la
Pérode Formative jusque là à peu
près inconnue - ou en tout cas très peu
étudiée.
La culture Vicús, sur laquelle se pencha alors
l'archéologue Luis Lumbreras, se développa sur
les bords du Rio Piura entre 500 avant J.-C. et 500
aprèsJ.-C.
Elle a laissé une très
riche céramique qui possède de nombreux points
communs avec celle d'autres cultures contemporaines
situées plus au Sud, dans les régions de
Trujillo et de Lambayeque : les cultures de
Cupisnique, Salinar, Galinazo, et plus
tard Mochica,
puis Lambayeque.
Vierges du Soleil - voir
Acclas
- Acclahuasi
|

Le huaco "astronaute"
de Vicus
|
VILCABAMBA
(Cordillière de)
Nom donné à la chaîne de montagnes et
à la région extrêment sauvage qui
s'étendent au Nord-Ouest de Cuzco. Elles doivent ce nom au Rio
Vilcabamba, affluent de la rive gauche du Rio Urubamba qu'il rejoint
à 20 kms en aval de Machu Picchu.
La cordillière de Vilcabamba fut le dernier refuge de la
dynastie Inca en lutte contre les envahisseurs espagnols.
Après le soulèvement de 1536, Manco Inca qui
avait tenté en vain de reprendre Cuzco, s'y réfugia et
de là, dirigea contre les conquistadors une longue guerre de
harcèlement jusqu'à son assassinat en 1544.
Des bords du Rio Vilcabamba, on peut suivre un ancien chemin
incaïque qui conduit au hameau de Vitcos dominé
par le cerro de Rosaspata où subsistent des vestiges
incas, malheureusement envahis par la végétation. Ce
site a été identifié par Hiram Bingham comme
étant l'ancienne forteresse de Vitcos, l'une des
dernières places fortes Inca, là-même où
Manco Inca aurait été assassiné par les
Espagnols et où son fils Titu Cusi continua la
résistance. A 45 minutes du hameau, se trouve Yuraq
Rumi, la "Pierre blanche", énorme rocher blanc en granit,
près d'une source, taillé de main d'homme de
manière à former des plateformes, des niches et des
cubes. Il est également nommé Nusta Ispana :
"les toilettes de la jeune fille".
A l'autre extêmité de la cordillière, près
de la rive droite du Rio Apurimac, on atteint l'hacienda
d'Espiritu Pampa sur la rive droite du Rio Apurimac, à
proximité de laquelle gisent dans une luxuriante
végétation les ruines de Vilcabamba la Vieja,
découvertes par Gene Savoy en 1960.
Vilcanota (Rio et cordillière
de)
Région géographique très montagneuse,
située à l'Est de Cuzco, où prend sa source le
rio Vilcanota qui en aval de Cuzco, reçoit le nom de rio
Urubamba.
Vilcashuaman
Perchée à 3600 m d'alt., cette pittoresque bougade de
la région d'Ayacucho fut sans doute au temps des Incas un
important centre administratif et religieux dont il subsiste
d'imposants vestiges dont le plus imposant est l'Ushno,
exemple quasi unique de pyramide inca, édifiée en
quatre terrasses de blocs de granit soigneusement appareillés.
La plateforme supérieure - où est déposé
un trône à deux places, taillé dans un seul bloc
- est accessible par un escalier monumental,
précédé d'une haute porte à encadrement
trapézoïdal. Depuis la plateforme, on aperçoit une
vaste esplanade, en partie occupée par les vestiges d'une
vaste demeure rectangulaire qui passe pour avoir été
une résidence de l'Inca Tupac Yupanqui, également
pourvue de portes trapézoïdales, et d'un bâtiment
plus petit, qui devait renfermer la garnison. L'esplanade devait
être ceinturée d'une enceinte, comme en témoigne
une grande porte et des frgments de murailles incas.


Vilcashuaman : la Piedra del Vaticino et l'église (photos D.
Duguay)
A peu de distance, face à la place
principale, l'église coloniale est assise sur les
vestiges du Temple du Soleil, en trois terrasses
superposées (les fondations de l'église étant
encastrées dans la troisième terrasse). La seconde est
ornée de nombreuses niches trapézoïdales, un grand
escalier dessert les gradins et aboutit devant le portail de
l'église. Cet ensemble étonnant et très
pittoresque fait assez penser au village de Chinchero, près de
Cuzco. Sur la place, on verra également un trône de
pierre et un monolithé évidé, baptisé
"pierre des Sacrifices".
En remontant la rue derrière l'église, on parvient
à un petit enclos où a été mise à
jour la Piedra del Vaticino (Pierre des augures), sorte
d'autel incliné et creusé de petits canaux en zigzag,
se rejoignant en un seul au bord de la pierre. Les sillons devaient
recueillir le sang d'un lama sacrifié et, suivant sa
trajectoire, les prêtres prédisaient les bonnes ou les
mauvaises années, les mariages heureux ou malheureux,
etc.
|
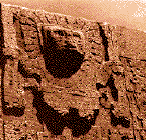
|
VIRACOCHA,
ou WIRAQOCHA (le dieu)
Cette grande divinité spirituelle paraît
être, pour le Pérou ancien, le pendant du
Quetzacoatl et du Kukulcan des Mexicains. Le sens profond du
nom de Viracocha reste obscur : il désignait le grand
dieu créateur des Péruviens, supérieur
même au Soleil dont prétendaient descendre les
Incas, et à la Lune (Quillamama) qui, selon
certains, est plus forte que le Soleil car elle luit aussi
bien la nuit. Le mythe de Viracocha est sans doute d'origine
aymara :
c'est un dieu créateur et nourricier, surgi
des eaux du lac Titicaca avec lequel il s'identifie. Mais il
est aussi fréquemment évoqué par le
motif du puma, comme sur la Porte
du Soleil de Tiahuanaco,
ou celui de l'éclair Ilac. Par la suite, il
s'identifia lui-même avec Kon-Tiki (qui est un
mot Chimú), dieu de la côte Nord du
Pérou, qui serait venu du Nord par la mer pour
créer le monde. Sans doute faut-il entendre dans ces
légendes l'écho de migrations anciennes : les
Chimú affirmaient être venus de l'océan
à bord de leurs radeaux...
|
L'instauration du culte de Viracocha ne
survint, chez les incas, que sous le règne de Pachacutec,
c'est-à-dire au moment où l'empire entrait dans une
grande phase d'expansion territoriale et nourrissait des
visées impérialistes sur les royaumes voisins. La
prédominance donnée à Viracocha sur le
dieu-Soleil n'est donc pas politiquement innocente : elle
répondait au besoin d'intégrer, par un
syncrétisme religieux volontaire, les régions proches
du Pacifique - et notamment le royaume Chimú - que les
souverains incas venaient de conquérir. Ainsi avait jadis
procédé Rome, grande assimilatrice de dieux, qui
ressucita même, lorsqu'elle devint impériale, la
divinisation pharaonique du souverain.
De Viracocha aux "Viracochas"
Par un subtil phénomène de transfert de pouvoir -
et donc de divinité - les Espagnols furent ainsi nommés
par les indiens aux premiers temps de la conquête parce qu'ils
portaient la barbe et avaient la peau blanche, selon l'image que les
incas se faisaient - selon ce qui a été prétendu
par la suite - du dieu Viracocha. La puissance de leur armement,
leurs chevaux et leurs cuirasses qui paraissaient les rendre
invincibles durent renforcer, dans l'esprit des populations
indigènes, l'aspect divin des conquérants. Cette
assimilation fut bien entendu encouragée par les Espagnols,
tout d'abord par le chroniqueur métis Santacruz
Pachacuti qui forgea sur commande la légende d'un
Viracocha blanc et barbu qui portait une croix et ressemblait donc
étrangement aux conquistadors... Dans les années qui
suivirent la conquête, les indiens avaient d'ailleurs pris
l'habitude d'appeller les hommes blancs "viracochas" ou "mistis" ,
habitude qui a survécu dans certaines régions andines
du Pérou et de la Bolivie.

Les impressionantes murailles du temple de Viracocha, à
Raqchi.
VIRACOCHA (Temple de)
Situé sur la route de Cuzco à Puno, peu avant
le col de la Raya, le site de Raqchi, tout proche du village
de San Pedro de Cacha, est célèbre pour l'immense
édifice ruiné que l'on aperçoit depuis la ligne
de chemin de fer de Puno à Cuzco : le temple dit de Viracocha,
long de 91 m sur 25 m de large. Il est formé d'un puissant mur
de refend, haut de 12 m, que jalonnent sur toute sa longueur des
colonnes cylindriques de 6,5 m de hauteur. Avec ses onze colonnes de
part et d'autre du mur, la salle à quatre nefs ainsi
constituée devait couvrir 2300 m2. Toute cette architecture
repose sur des bases construites en pierres de taille jusqu'à
hauteur d'homme, et des parois de terre battue (ou d'adobes) les
surmontent. Avec sa toiture à deux pentes et sa couverture de
chaume, ce temple de Viracocha devait représenter l'une des
plus vastes réalisation d'espace interne qu'ait jamais
édifié le monde Inca.
La statue du dieu Viracocha, qui en occupait le centre et qui fut
détruite par les Espagnols correspondait là aussi,
selon la description de Garcilaso de la Vega, à celle d'un
homme de haute stature, la peau claire et muni d'une longue
barbe.
Wanpu
Embarcation typique de la côte du Pérou à
l'époque de la culture Chincha
jusqu'au temps des derniers Incas. Les Chinchas, qui
entretenaient des relations commerciales avec le golfe de Guayaquil,
construisaient et utilisaient cette sorte de grand radeau muni d'une
voile carrée.
Le wanpu consistait en un nombre impair de gros troncs de longueur
décroissante, fixés par des cordes (on ignorait le
clou), à deux autres troncs placés en travers; on liait
dessus un pont de minces rondins : le tout en bois de balsa. Un
mât et des perches antennes portaient une voile de
coton. Un système de traverses plus ou moins
enfoncées à la poupe servait à gouverner et des
pierres, à jeter l'ancre. Vers l'arrière se dressait
une sorte de "cabane-cabine". Les plus grands jaugeaient 30
tonneaux et pouvaient embarquer 50 personnes.
C'est l'un de ces navires que le pilote Bartolomé Ruiz
accosta, lors du second voyage d'exploration de Pizarro le long des
côtes du Pérou en 1526.
|
WARI
(empire) - voir Tihuanaco-Huari
Wilkawain
Situées dans l'Estancia de Paria, à 7 km de la
sortie nord de Huaraz, dans le Callejon de Huaylas, se
dressent les ruines d'un temple dont l'origine remonte
à la période d'expansion du royaume Wari (900
après J.-C.), dont elles sont l'une des traces les
plus septentrionales.
S'élevant sur trois plateformes entourés d'une
épaisse muraille de 90 m de long sur 30 m de large,
les bâtiments sont percés de portes et de
fenêtres trapézoïdales, signe d'une
ré-occupation à l'époque inca.
D'après la légende, une statue en pierre du
dieu Viracocha se dressait au sommet de ce
temple-forteresse.
|

Temple de Wilcawain
|
Sommaire
/ Introduction
/ Archéologie
/Bibliographie
/ Chronologie
![]()
![]()
![]()



