![]()
Chacra
Mot quechua : terrain agricole de dimensions réduites
où les paysans et les petits propriétaires de
communautés andines sèment et récoltent les
cultures céréalières nécessaires à
l'alimentation de la famille.
Chaku
Cérémonie traditionnelle des indiens quechuas,
remontant à l'époque incaïque : la tonte du pelage
du dos de la vigogne, que présidait personnellement l'Inca
lui-même, en présence des Vierges du Soleil. La
tradition a perduré jusqu'à nos jours, sauf qu'un
acteur de village joue le rôle de l'Inca et que des figurantes
remplissent celuis des Acclas d'autrefois.
L'origine de cette cérémonie remonte certainement aux
grandes chasses rituelles au guanaco et à l'alpaca des indiens
du Collao ainsi que des peuplades
préhistoriques qui les ont précédé sur
l'altiplano, comme en témoignent les nombreuses scènes
cynégétiques du sanctuaire rupestre de Mazo Cruz
où les animaux représentés sont tous des
auquénidés.
CHALCUCHIMAC (ou
CALICUCHIMA)
Grand général Inca, d'abord au service de
Huayna
Capac, il devint après la
mort de l'Inca l'un des principaux chefs militaires d'Atahualpa. Il
vainquit les troupes de Huascar à Qupaypampa et fit son
entrée à Cuzco, en compagnie d'un autre
général d'Atahualpa, le terrible Quizquiz auquel on
attribue la répression féroce et le massacre de la
famille de Huascar.
Il semble que des trois grands généraux d'Atahualpa
(Ruminahui, Quizquiz et lui-même), Chalcuchimac ait
été la tête la plus politique.
Chalona
Mot quechua : viande séchée de mouton, qui
servait et sert encore d'aliment aux Indiens des Andes. N'est pas
à confondre avec le charqui, préparation de
viande de lama déshydratée, qui évoque le
pemmican des Indiens d'Amérique du Nord.
CHAN CHAN - V. page : La fastueuse cité de CHAN CHAN
CHANAPATA
Style de céramique propre à la région de
Cuzco, mais très antérieur au style inca dit
"impérial", puisque remontant probablement à la
Période Formative. Ce style, dans cette même
région, fut précédé de celui de
Marcavalle et suivi par des phases correspondant à
l'horizon Tihuanaco-Huari.
A Chanapata, aux environs immédiats de Cuzco, J. H. Rowe fit
en 1941 quelques sondages sur un site où des travaux de voirie
avaient mis au jour un pan de mur grossier et des tessons de poterie
de type non inca. Il mit au jour une construction semi-souterraine et
quelques tombes rondes ou ovales qui lui permirent de recueillir de
nombreux tessons de poterie. Il s'agit surtout d'une poterie dure,
brune, rouge terne ou noire, unie ou ornée d'incisions ou
d'applications et quelquefois polie. On trouve des jarres à
col, des assiettes et des bols de diverses formes, notamment des bols
à base plate et aux parois verticales ou
évasées. On a relevé aussi quelques fragments
d'une poterie plus fine, peinte en deux couleurs seulement, comme
dans les autres cultures de cette période. Les dessins sont
extrêmement simples : des cercles et des gradins blancs sur
fond rouge ou rouges sur fond jaune clair.
Chancas
Peuplade de la Sierra Centrale du Pérou qui occupait,
avant, pendant et même après l'hégémonie
inca, une vaste région qui correspondrait aux
départements actuels d'Ayacucho et d'Apurimac. Son berceau
aurait été les rives de la lagune de Choclococha,
à 4605 m d'altitude, dans la province de Castrovirreyna. Elle
était voisine des Huancas, au Nord-Ouest et des Quechuas au
Sud-Est.
Réputée très belliqueuse, la nation Chanca se
posa d'abord en rivale du royaume naissant des Incas et ses guerriers
déferlèrent sur Cuzco vers 1430, où ils furent
défaits par le prince Inca Yupanqui, fils de l'Inca Wiracocha,
qui devait régner plus tard sous le nom de Pachacutec.
Plus tard, elle défendit avec acharnement son territoire
contre l'invasion inca, menée vers 1450 par le même
Pachacutec.
Passés sous le joug inca vers 1450, les Chancas se
soulevèrent maintes fois, à l'instar de leurs voisins
les Huancas contre l'autorité du Cuzco. Les historiens
modernes ont démontré à quel point l'aide qu'ils
apportèrent aux Espagnols lors de la conquête du
Pérou fut déterminante dans la chute de l'empire
Inca. En 1536, ils refusèrent de se joindre à la
grande rebellion de Manco Inca qui, en sus des Espagnols, dut
encore guerroyer contre eux jusqu'en 1540.
CHANCAY Hormis la céramique, la culture de Chancay se
distingue par un art textile très riche,
hérité des précédentes cultures
de Paracas. Moins riche en couleur cependant et plus
influencé par les thèmes religieux, il ne fut
vraiement découvert et apprécié
qu'à partir des années 50, lorsque le
célèbre collectionneur Yoshitaro Amano
s'interessa aux pièces de textile que les pilleurs de
tombes (les huaqueros) avaient ignoré.
Culture de la Côte centrale, contemporaine de l'époque
de splendeur du royaume Chimú. On la retrouve surtout dans les
vallées du Rio Chancay et du Rio Chillon, mais son influence
s'étendit depuis Huaura jusqu'à Lurin.
La culture Chancay a surtout été décrite en
fonction de la céramique retrouvée, le plus souvent
dans des cimetières comme ceux d'Ancon et de la vallée
de Chancay. Cette céramique est plutôt frustre,
comparée à celle des Mochica ou des Nazca, et le
décor peut être en relief ou peint en noir ou brun
foncé sur un fond crème. Les formes des vases sont
assez variées, mais les récipients à corps
ovoïdal prédominent. Les plus connues sont pourtant les
figurines anthropomorphes représentant des femmes,
généralement les bras ouverts, et dont les yeux sont
prolongés par une ligne qui représente,
peut-être, une peinture faciale.
Les motifs qui décorent la céramique sont
généralement géométriques mais il y a
aussi des représentations d'animaux, d'hommes et de
plantes.
A cette tradition textile se rattache les fameuses
"poupées (muñecas) Chancay". Ces
petites figurines réalisées en tissu
étaient disposées autour des fardos
funéraires des momies, très certainement
à des fins magiques. Certaines d'entre elles semblent
évoquer des scènes de la vie du défunt,
ou des personnes qui lui étaient chères; ce
qui était une façon de l'accompagner dans
l'autre monde...

les "poupées Chancay"
Chasqui
Mot quechua désignant les courriers de l'Inca.
"Ils appelaient chasqui les courriers qu'ils postaient sur les
chemins afin de faire savoir en peu de temps les ordres du roi, et
porter les nouvelles et les avis des choses qui se passaient ou
près ou loin dans ses provinces et ses royaumes. Ils avaient
à cet effet à chaque quart de lieue quatre ou six
indiens jeunes et dispos, qui se tenaient dans deux cabanes pour se
mettre à l'abri des inclémences du ciel. Ils portaient
les messages à tour de rôle, tantôt ceux d'une
cabane, tantôt ceux de l'autre. Les uns regardaient d'un
côté du chemin, et les autres de l'autre
côté, pour découvrir les messagers avant qu'ils
n'arrivent jusqu'à eux, pour se tenir prêts à
recevoir le message, sans perte de temps. A cet effet, ils mettaient
toujours ces cabanes sur des hauteurs, de telle sorte qu'elles
fussent bien en vue les unes des autres. (...) On les appelait
chasqui, c'est-à-dire échanger, ou encore donner
et prendre, ce qui revient au même, parce qu'ils
échangeaient, donnaient et prenaient de l'un à l'autre,
et ainsi successivement, les messages qu'ils portaient."
Garcilaso de la Vega, Commentaires Royaux, VI, 7).
Chasseurs
primitifs
Il est maintenant confirmé que dès la fin du
dernier épisode froid, connu aux Etats-Unis sous le nom de
glaciation "Valders" ( période qui correspond au
haut-Holocène des géologues), les Andes centrales ont
été habitées par de nombreux groupes humains,
dont le mode de vie a déjà pu être partiellement
reconstitué.
Ces bandes nomades menaient l'existence typique des
sociétés dites "archaïques", terme employé
par les auteurs nord-américains, alors que les auteurs
européens emploiraient plutôt dans ce cas celui de
"mésolithique"
Des vestiges âgés de 10 500 à 7000 ans avant nos
jours ont été trouvés aussi bien dans des
grottes que dans des sites de plein air. En ce qui concerne les Andes
centrales, les grottes déjà explorées sont
celles de Lauricocha
, dans la puna de Pasco, à 3900 m d'altitude, où
il pleut un mètre d'eau par an; celle de Toquepala
dans le grand Sud péruvien très aride, également
à haute altitude, et enfin celle où fut
découvert l'Homme de Chilca dans le Pérou
Central.
CHAVIN - V. page : Les Mystères de CHAVIN
|
Chemin
de l'Inca Le Chemin de
l'Inca,
|
 |
CHIMU (civilisation et empire) - V. page : La fastueuse cité de CHAN CHAN
CHINCHA-ICA
(culture)
Sur la côte Sud du Pérou, l'état de
Chincha occupait, vers les 10e-13e siècles, les vallées
de Chincha, de Pisco, d'Ica et de Nazca, peut-être aussi la
vallée de Cañete, plus au Nord, où l'on a
relevé la présence de poterie de style inca. Les
chroniques nous parlent de Chincha comme d'un Etat puissant qui
cherchait à s'étendre à l'Est au-delà des
montagnes. Les Incas ne l'auraient réduit qu'après de
longues et dures campagnes.
Il ne semble pas que les Chinchas aient atteint le même
degré d'organisation que le royaume Chimú. Si les
Chinchas ne furent pas de grands architectes, il semble par contre
qu'ils aient été d'excellents marins. Probablement
dès avant l'époque de la domination Inca et jusqu'au
16e siècle, ils possédèrent une marine marchande
qui leur permettait d'entretenir des échanges commerciaux
jusqu'en Amérique Centrale.
C'est un de ces navires - de grands radeaux équipés
d'une voile, embarcations de cabotage appellés
wanpus
- que le pilote Bartolomé Ruiz rencontra, lors du second
voyage de Pizarro vers les côtes du Pérou en
1526.
CHINCHAYSUYO
Division Nord du Tahuantinsuyo,
dans l'empire des Incas. Le Chinchaysuyo comprenait les territoires
s'étendant au Nord-Ouest de Cuzco, ainsi que toute la
côte Centrale et Nord du Pérou, depuis Chincha
(d'où son nom) jusqu'à Quito, englobant ainsi les
terres de l'ancien royaume du Gran Chimu.
CHINCHERO (ou CHINCHEROS)
Cette bourgade, située à une vingtaine de
kilomètres au Nord-Ouest de Cuzco, a conservé de
nombreux vestiges incas et ses habitants, à
prédominance indigène, vivent dans les murs mêmes
de leurs ancêtres. L'on rapporte que Chinchero fut l'un des
sites favoris de l'Inca Tupac Yupanqui, qui y construisit un palais
et fit aménager d'imposantes cultures en terrasses
(andenes) dans la vallée du rio Vilcanota.
Le monument le plus importants du village est formé par le
recinto en appareillage inca, orné de niches
trapézoïdales, qui délimite la place du
marché, face à l'église. C'est d'ailleurs sur
cette place que l'on peut toujours observer, les jours de
marché, la vieille coutume préhispanique du troc des
productions agricoles, toujours en vigueur parmi les
paysans.

Chipayas
Vieille tribu des rives du lac Titicaca, distincte des Aymaras et des
Quechuas, que l'on suppose être, comme les Uros,
l'une des dernières branches du peuple Puquina,
chassé des hauts-plateaux par les invasions des
Aymaras
au 12e siècle.
Tout comme les Uros, les Chipayas vivent à l'écart et
parlent une langue qui leur est propre. Plusieurs ethnologues les
considèrent comme les véritables autochtones de la
région du lac Titicaca. On leur attribue la construction
des chullpas,
tours rondes ou carrées, hautes de 4 mètres, en terre
ou en pierre, dont les murs peuvent avoir jusqu'à 80 cm
d'épaisseur. Elles servaient jadis d'habitations ou de
sépultures, ce qui paraît d'autant plus curieux que les
indiens actuels ont une telle peur des morts qu'ils contournent
craintivement les chullpas.
CHIRIPA,
culture
Une des cultures de la Période Formative de
l'Altiplano andin (de 1400 jusqu'à J.-C.), avant le
développement et l'expansion de la civilisation de
Tihuanaco.
Formée par des chasseurs insulaires et des pêcheurs
établis sur la rive Sud-Est du lac Titicaca (aujourd'hui
située en territoire Bolivien), elle est connue pour son style
lithique étudié par E. Harth-Terré (la
stèle de Chiripa).
Fouillé par Bennett en 1934, le site de Chiripa est un village
formé de quatorze maisons de forme rectangulaires
réunies sur les trois côtés d'une place - ou d'un
temple - semi-souterrain, construites en adobes,
élevées sur des fondations de pierres et couvertes
à l'origine d'une toiture d'herbe. Des murs doubles, dans
l'intervalle desquels se trouvaient des coffres à provisions
et des portes coulissantes en bois, protégeaient du froid. Le
plan de ce site est assez semblable à celui de
Pucara
(sur la rive Nord-Est du lac) qui en est une réplique plus
tardive.
Le type usuel de la poterie Chiripa est un bol aux parois
épaisses et verticales monté sur une base plate, peint
de dessins géométriques en gradins jaunes sur un engobe
rouge. Comme la peinture blanche sur rouge de la côte, c'est
sans doute ici un premier essai de décoration peinte.
Les Chiripas avaient domestiqué le lama et l'alpaca; ils
cultivaient la pomme de terre et des graminées telles que la
quinua et la kiwicha. Ils avaient mis au point un ingénieux
système de cultures dans les zones basses ou inondables
proches du lac : un réseau de légers monticules ou de
plateformes artificielles de sol fertile étaient cernés
par des fossés peu profonds remplis d'eau. Le jour, le
rayonnement du soleil réchauffait cette eau qui la nuit
restituait sa chaleur et constituait une sorte de protection
thermique contre les gelées. Ce système connu sous le
nom de waru-waru, fut aussi exploité sur la rive Nord
du lac, où son existence fut révélée lors
des grandes inondations de 1981 dans la région de Puno et de
Juliaca par l'archéologue Clarck Erickson et
l'ingénieur agronome Ignacio Garaycochea, intrigués par
l'émergence de ces îlots au dessus du niveau maximal des
crues. dans la région de Puno et Juliaca. Les agriculteurs
Lupacas, au temps des Incas, furent sans doute les derniers à
l'utiliser. Il fut abandonné après la Conquête et
la pampa, abandonnée aux grandes harbes rases, ne fut plus
vouée qu'aux pâturages.

CHONGOYAPE (pétroglyphes de)
A quelques 60 km au Nord de Trujillo, dans les environs du lac de
barrage de Tinajones, au lieu-dit Cerro Mulato, se trouvent, par
centaines sur des rochers, les fameux pétroglyphes de
Chongoyape, ornés de dessins de style chavinoïde.
Des fouilles effectuées près de ce site en 1928, mirent
à jour de magnifiques bijoux en or ciselé (bagues,
anneaux, bracelets) où l'on retrouve des motifs semblables
à ceux du temple de Chavin.
Chonta
Cet arbre, palmier à bois noir extrêmement dur,
était utilisé pour la fabrication des armes (lances,
javelots, arcs) ou des instruments aratoires. Les longues
épines de chonta (20 à 25 cm) se trouvent en grand
nombre dans les paniers à coutures des momies, soit
percées d'un chas (aiguille à coudre) ou comme
aiguilles à tisser.
CHOQUEQUIRAO
Perché à 3150 m d'alt. sur la rive droite du
Cañon du Rio Apurimac, entre Abancay et Cuzco, et
soigneusement restauré et remis en valeur lors de ces
dernières années, ce site archéologique
exceptionnel n'est pas sans évoquer Machu Picchu, en plus
petit, voué à devenir bientôt l'un des attraits
touristiques majeurs de la région de Cuzco.
Considéré comme un centre cérémoniel
voué au culte du Soleil, de l'Eau et des Apus (esprits de la
montagne), il fut probablement érigé sous le
règne de l'Inca Pachacutec. Le site est constitué de
deux parties distinctes, séparées par un fort
dénivellé où a été
aménagé un canal d'irrigation et un escalier
monumental, qui fait penser à celui de Winay Wayna (proche de
Machu Picchu).
. En bas, le secteur agricole comprend des terrasses de cultures, un
groupe d'habitations et une place cérémonielle. Plus
haut, le secteur des palais et des temples présente de belles
constructions incaïques avec des portes et des fenêtres
trapézoïdales à double et triple jambage. Les
constructions ne sont pas faites de blocs monolithiques - sans doute
faute de carrières proches - mais de dalles de pierre
soigneusement taillées.
CHOQUESUYSUY
Ensemble de ruines visitées par Hiram Bingham en 1915,
puis par Paul Fejos et Werner Green lors de l'expédition de la
Fondation Viking en 1940-41. Ce site, situé au Sud de Machu
Picchu est divisé en deux parties, de part et d'autre d'un
ravin. Le premier secteur présente deux groupes d'enclos
murés avec de larges terrasses et le second, six groupes
d'enclos également munis de terrasses, celles-ci plus
étroites. A ces structures s'ajoutent des allées en
escalier, présentant parfois des marches monolithes,
taillées dans le roc et des cuves ou bassins circulaires qui
laissent à penser qu'on y rendait un culte à
l'eau.
|
CHUCUITO
Monolithe phallique de Chucuito. |
 |
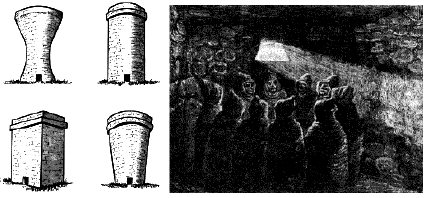
Chuño
Ce mot quechua désigne la pomme de terre lorsqu'elle
est déshydratée, selon un procédé
qu'utilisent encore très couramment de nos jours les paysans
des Andes.
Garcilaso de la Vega (Commentaires Royaux, V,5) est l'un des premiers
chroniqueurs à en avoir fait mention :
"Dans toute la province des Collas, sur une étendue de plus de
cent cinquante lieues, le maïs ne pousse pas, parce que le
climat est trop froid. On récolte quantité de quinoa,
qui est comme du riz, et d'autres graines et légumes qui
fructifient sous la terre : parmi eux il y en a un qu'ils
appellent papa : il est rond et fort sujet à se
corrompre à cause de son humidité. Pour empêcher
que cela n'arrive, ils mettent les papas , ou pommes de terre,
sur de la paille, car on en trouve d'excellente dans cette
contrée; ils les exposent à la gelée pendant
plusieurs nuits; en effet, pendant toute l'année, il
gèle fort dans cette province; et pendant que le gel les a
brûlé comme si elles avaient cuit, ils les recouvrent de
paille et les pressent doucement pour en faire sortir
l'humidité qui leur est naturelle ou que la gelée leur
cause. Puis ils les mettent au soleil et les préservent du
serein jusqu'à ce qu'elles soient entièrement
désséchées. Préparée de cette
façon, la papa se conserve longtemps, et prend le nom
de chunu . C'est ainsi qu'ils séchaient les pommes de
terre qu'ils récoltaient sur les terres du Soleil et de
l'Inca, et ils les conservaient dans les magasins avec les autres
légumes et graines."
Chuspa
Sac de laine de forme carrée, orné de motifs
aux couleurs vives, que tissaient les Incas pour transporter leur
nourriture ou les feuilles de coca.