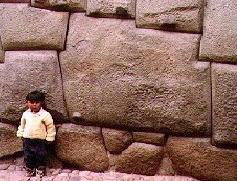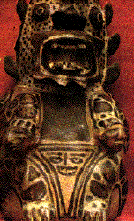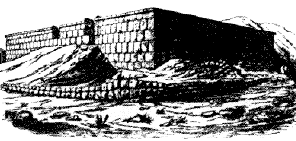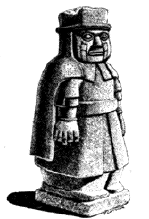|

|
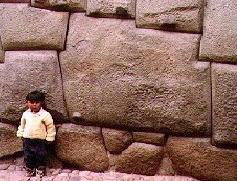
|
La fameuse Hatun Rumiyoc, ou "Pierre aux douze angles" à Cuzco.
|
Las
HALDAS
La plaine de Haldas, située sur la côte Nord du
Pérou, forme un croissant long de 12,5 km de long et large au
centre de 1400 m. Cette plaine avait déjà
été habitée dans les temps pré-agricoles
par des pêcheurs qui y avaient édifié des
villages de huttes; puis elle a connu une occupation très
dense durant la phase moyenne de la civilisation des planteurs de
haricots , ou premiers
Agriculteurs , vraisemblablement
vers 2000 avant notre ère.
Après une période d'abandon de cinq siècles, les
agriculteurs du stade ultérieur, celui des planteurs de
maïs et utilisateurs de céramique y sont apparus vers
1500 avant notre ère. Des tertres de forme rectangulaire,
bordés de murets de pierre formant généralement
une succession de trois ou quatre gradins, ont alors
été édifiés en nombre au centre de la
plaine. Des cendres et des débris de poterie indiquant qu'il
s'agissait d'habitats se trouvent sur ces tertres, où existait
vraisemblablement une maisonnette au toit et aux parois de roseaux
supportés par des poteaux. Certains de ces tertres
étaient surmontés d'un édifice plus important,
dont il subsiste la base de murs de pierre, et qui peuvent avoir
joué un rôle cérémoniel.
Hatun Rumiyoc (Pierre aux douze angles) -
V. Page : CUZCO
ou le "nombril du monde"
HATUNCOLLA
Site pré-incaïque de l'Altiplano Péruvien
au bord du lac Umayo (à proximité de la rive Ouest du
lac Titicaca). La zone archéologique d'Hatuncolla est connue
depuis le siècle dernier pour ses stèles à
figures géométriques qui sont l'une des expressions de
la lithosculpture commune aux cultures de la Période Formative
qui précédèrent, dans la région du lac
Titicaca, le développement de la civilisation de Tihuanaco
(Pucara, Taraco, Chucuito, etc.)
Toutes proches du village actuel de Hatuncolla, se dressent les
fameuses chullpas
de Sillustani
dans lesquelles certains voient
les restes de la nécropole de Hatuncolla, et d'autres des
monuments funéraires très postérieurs (voire
même incas) à la culture de Hatuncolla.
Hatunruna
Au temps des Incas, ce mot quechua (hatun : grand et
runa : peuple) désignait "le plus grand nombre",
c'est-à-dire la majorité du peuple, ou la grande masse
plébéienne des paysans, artisans, des pêcheurs et
des bergers. Les hatunrunas , qui représentaient 90 %
de la population de l'empire, se trouvaient au-dessous des
aristocraties incas ou locales, mais au-dessus des yanas
, qui eux, étaient des sortes de serfs attachés
à un seul maître.
Huaca
Désignait, dans le Pérou préhispanique,
tout objet ou tout lieu empreint de force surnaturelle et auquel il
fallait rendre un culte. Par extension, ce mot s'applique aujourd'hui
aux ruines, aux anciens lieux d'habitation et jusqu'aux vases
(Huacos) trouvés dans les tombes. Les huaqueros
sont des pilleurs de tombes.
HUACA DE LA LUNA _ v.
MOCHE
(Pyramides de)
HUACA DEL SOL (Trujillo) _ v.
MOCHE
(Pyramides de)
HUACA EL DRAGON
A 5 km au Nord de Trujillo, au bord de la route
Panaméricaine, près d'un petit musée,
s'élève ce temple pyramidal aujourd'hui
restauré, qui était peut-être consacré
à l'arc-en-ciel. Le parement extérieur de son enceinte
conserve des restes de frises comportant des bas-reliefs
représentant des guerriers superposés ou des serpents
bicéphales.
Le temple comprend une plateforme dominant trois séries de
cellules à ciel ouvert, qui devaient jadis être
couvertes. La plateforme est accessible par une large rampe
coudée et dallée.
HUACA
PRIETA
Proche du village de Chicama, à 35 km au Nord de
Trujillo, cette pyramide de la Période Formative, remonterait
de 1500 à 500 avant J.-C. Elle est le plus ancien
élément du complexe archéologique aujourd'hui
dénommé El
Brujo. Autour d'un temple dont
il subsiste des murailles hautes de 12 m, furent découverts,
comme à Virú, des restes d'habitations
semi-souterraines dont les toitures étaient formées de
traverses en bois et parfois d'os de baleines.
Les fouilles les plus profondes effectuées en 1925 par
Junius
Bird dans ce site,
donnèrent naissance à la théorie d'une
culture précéramique dans le Nord du
Pérou.
Plus récemment, on a associé la culture de Huaca Prieta
à la naissance de l'art textile péruvien. Dans ce
même site furent trouvés près de 3000 fragments
de tissus, la plupart en coton, fabriqués suivant trois
techniques élémentaires : entrelacé,
annelé et noué, où apparaît l'un des plus
anciens motifs connus : le condor aux ailes déployées .
Huancas
Peuplade des Andes Centrales, établie dans la
vallée du rio Mantaro (qui avant 1782 était
dénommé Jatunmayo, ou Huancamayo). A partir du premier
millénaire après J.-C., les Huancas dont la
constitution en tant que nation remonte à la fin de la
période d'expansion Tiahuanaco-Huari,
forment un puissant royaume uni et cimenté par leur ardeur
belliqueuse, à l'image de leurs voisins les Chancas.
Les Huancas, après plusieurs années de farouche
résistance, furent soumis par l'Inca Pachacutec, vers 1460.
Leur capitale, Siquillapucara fut la dernière forteresse
à se rendre au terme d'un long siège, après quoi
sa population fut déportée en masse vers la
région de Chachapoyas.
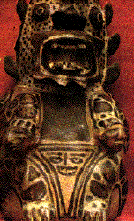
|
Les Huancas, comme les autres
nations de l'aire andine, admettaient comme suprême
créateur le dieu Viracocha; ils adoraient une autre
divinité qu'ils considéraient, aux dires de
Guaman Poma de Ayala, comme une sorte de dieu national :
Wallallo Karwancho, auquels ils dédiaient des
sacrifices d'êtres humains, de chiens, et des
offrandes de coca. Ce n'est pas une déification du
chien, comme l'écrivent à tort Cieza de
Léon et Garcilaso de La Vega, pour une fois unis dans
l'erreur. Cette affabulation a dû être
forgée par les Incas de Cuzco, dans le but sans doute
de discréditer la religiosité des Huancas,
qu'ils avaient soumis, et de justifier a-posteriori leur
impérialisme :
"Les Huancas avaient d'étranges coutumes, comme de
gonfler de cendre la peau de leurs victimes, et de les
pendre dans un temple en guise de trophées. Ils
faisaient aussi avec les têtes de chiens une sorte de
trompe et ils soufflaient dedans lors de leurs fêtes
et de leurs danses; c'était une musique très
douce à leurs oreilles..." (Garcilaso de La
Vega).
|
HUANUCO PAMPA (ou HUANUCO VIEJO)
A proximité des sites primitifs de Kotosh et de
Chavin, sur un plateau à 3600 m d'altitude, près du
fleuve Huallaga et du petit rio Ayararacra qui le traverse en partie,
cette ancienne capitale de province, jadis appelée
Huanucopampa, aurait été fondée par l'Inca
Tupac
Yupanqui
sur l'emplacement d'une cité
plus ancienne pour surveiller le chemin qui menait de Cuzco à
Quito. Elle fut explorée depuis le 19e siècle, en
particulier par George Squier.
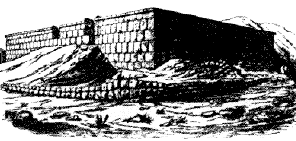
Le "Castillo" de Huanuco Pampa (dessin de George
Squier)
La ville se développe à partir
d'une vaste esplanade, au centre de laquelle se dresse un
édifice cérémoniel, le "Castillo", énorme
édifice de 250 m2 avec des murs constitués de pierres
travaillées où s'ouvrent des portes
trapézoïdales sculptées d'animaux (félins
et reptiles) en haut-relief. Les grandes dimensions de cette place
peuvent s'expliquer comme ayant servi de foitrail, ou de
marché à bestiaux dans une région où
l'élevage des auquénidés était
particulièrement développé. Le chemin
de l'Inca qui reliait Cuzco
à Quito traversait la ville de part en part et aboutissait
à cette esplanade.
Autour de la grand-place se dressent une série
d'édifices et de quartiers : l'Incahuasi (maison de l'Inca),
l'Acclahuasi (maison des femmes choisies), une caserne, et le
"puquio", ou quartier des éléveurs.
Plus au Nord, de l'autre côté de la rivière,
s'étend un vaste quartier résidentiel, structuré
autour d'une place centrale et de plusieurs patios.
Hors de la ville, en direction du Sud-Ouest, se situe la zone des
collcas, ou dépôts, de forme circulaire ou
carrée, disposés en gradins sur le versant d'une
colline. On en a dénombré à peu près 500.
Il semblerait qu'à l'arrivée des Espagnols, le site
était déjà abandonné.
Huaquero
Mot espagnol signifiant "pilleur" ou "violeur" de
tombes. Les huaqueros fouillent pour leur propre compte les
huacas , ou pyramides, d'où leur nom. Pour les
archéologues, l'action des huaqueros sur un site
représente évidemment une véritable catastrophe,
autant pour les dégats causés aux sépultures que
pour le vol des objets qu'elles renferment. Pendant des
décennies, une bonne partie des trésors
archéologiques du Pérou (céramiques, tissus,
bijoux, momies...) ont été pillé et vendus -
souvent à des étrangers - par leurs soins. Une loi
de 1968 qui interdisait l'exportation des céramiques et autres
objets du patrimoine national, tout en réprimant les
"fouilles" sauvages, a quelque peu limité cette
hémorragie qui malgré tout persiste aujourd'hui
encore.

Un huaquero en action.
HUARI ou WARI
(site de)
Le site de Huari (ou Wari), dans les hautes terres des Andes
centrales, près d'Ayacucho, est considéré par
les archéologues comme un "site-relais" entre la civilisation
de Tiahuanaco et son expansion vers la côte et le reste du
Pérou. Cette phase expansionniste a donc pris le nom de
Tiahuanaco-Huari.
|
Huari était un centre
habité, protégé par des murs grossiers,
où Bennett a retrouvé un certain nombre de
statues et quelques traces d'architecture - qui, bien que
moins évoluée que I'architecture de
Tiahuanaco, y trouve peut-être son origine. Dans le
domaine de la poterie, on relève un style polychrome
qui appartient à la tradition de la côte
péruvienne dans lequel on trouve pourtant ces traits
dérivés de Tiahuanaco : figure divine avec
bâtons de commandement, crânes, profils de pumas
et têtes de condors.
Le bassin du rio Mantaro reste encore une région
assez peu connue, et les origines de la culture de Huari
demeurent obscures, comme aussi son aire d'expansion.
Pendant la Période Formative, c'est la culture
Huarpa qui occupait la région. Les Huarpas
étaient un peuple d'agriculteurs qui avaient
déjà mis en oeuvre le système des
cultures en terrasses.
|
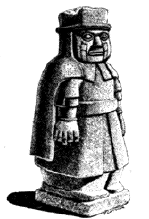
Monolithe de Huari
|
Selon W.C. Bennett, l'influence de Tiahuanaco
sur Huari paraît s expliquer par une invasion des peuples
aymaras venus de la région du lac Titicaca. Ces derniers
auraient ensuite constitué un état puissant, dont la
forme politique reste inconnue. Les historiens désignent en
général cette période de domination sous la
formule d'empire Wari.
Huayno
Danse agile et grâcieuse, typique des Indiens quechuas,
d'origine incaïque. Chant ou musique de rythme vif et paroles
picaresques ou moqueuses. Dans le huayno des sierras défile le
paysage, et l'homme décrit sa vie, ses sentiments, ses
rêves face à la géographie grandiose, mais
inhumaine.
Sommaire
/ Introduction
/ Archéologie
/Bibliographie
/ Chronologie